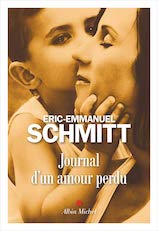Le Monde - « Toujours se rappeler qu’on est vivant. »
Romancier et dramaturge, membre de l’académie Goncourt, réalisateur et comédien, Eric-Emmanuel Schmitt publie Journal d’un amour perdu, en hommage à sa mère, et joue sur la scène de son théâtre (le Rive Gauche, à Paris) sa pièce Madame Pylinska et le secret de Chopin. A 59 ans, il est l’un des auteurs francophones les plus traduits et joués à l’étranger.
Je ne serais pas arrivé là si… Si je n’avais pas eu la chance de rencontrer une femme amoureuse de la vie, des arts, du théâtre, de la littérature, à la fois généreuse, passionnante et passionnée : ma mère. J’ai l’impression que ma vie, c’est son œuvre, et cela me va très bien. Il y a des fils qui veulent rompre, s’opposer, au contraire, moi, je me définis par la continuité. Depuis qu’elle est partie [en mars 2017], ce n’est pas une mère qui me manque, c’est elle.
Dans « Journal d’un amour perdu », le livre que vous lui consacrez, vous écrivez : « La clé de mon destin, c’est que j’ai cru au regard de ma mère » … Le regard qu’on pose sur vous, c’est extrêmement important. Le sien était un regard aimant qui me rendait aimable, qui me donnait confiance en moi et en la vie. Tout en m’acceptant tel que j’étais, elle me poussait et cherchait le meilleur en moi. Ancienne sportive de haut niveau, compétitrice, elle avait l’idée que, lorsqu’on fait quelque chose, il faut essayer de toucher le meilleur, autrement, autant rester à sa place.
Mais cette mère sprinteuse, devenue professeure d’éducation physique et sportive (EPS), ne vous a jamais poussé dans le sport. Du tout. Alors que mon père, ancien boxeur et judoka devenu kiné, qui n’a jamais été au même niveau, y accordait beaucoup d’importance. Il avait le culte de l’effort, elle, pas du tout. Cela a été tellement naturel pour ma mère de courir vite qu’elle n’y a pas spécialement prêté attention et s’est retrouvée championne. Moi, pendant des années, cela m’était tellement naturel d’écrire que je n’y prêtais pas non plus attention. J’étais persuadé que tous les enfants quand ils rentraient chez eux après l’école, écrivaient.
Qu’écriviez-vous enfant ? Des histoires de cape et d’épée, parce que j’avais lu Les Trois Mousquetaires. Et j’ai voulu faire des tas d’autres choses que l’écriture. Mais une vocation, c’est quelque chose de sourd, d’insistant. Ce n’est pas une révélation, c’est une nécessité de nature qui finit par s’imposer. Tout le monde m’avait diagnostiqué comme écrivain, sauf moi.
Qui a été le premier à vous « diagnostiquer » ? Mon professeur de français-latin-grec, M. Barney, en classe de 4e. J’étais au lycée Saint Just à Lyon, là où ma mère enseignait l’EPS. Ils se rencontraient dans la salle des profs et M. Barney lui avait dit que j’étais un « écrivain-né ». Régulièrement, il repérait dans mes textes l’influence de mes lectures. Car j’étais un caméléon. Puis, à 16ans, en me remettant le prix de la Résistance, Alban Vistel [compagnon de la Libération, écrivain et éditeur de bandes dessinées] m’avait glissé à l’oreille : « Vous trouverez votre salut dans l’écriture.»
Vous avez été, dès l’enfance, en conflit avec votre père. Vous parlez même de « défiance ». Pourquoi ? Je le refusais comme père. Comme il m’avait vu naître avec un bec-de-lièvre, il ne me caressait pas, il m’auscultait. Il a eu peur pour moi presque toute sa vie. J’ai répondu à sa méfiance par une défiance. Et puis, il faisait partie des gens qui croient avoir toujours raison. Je ne supporte pas ça. On était aux antipodes. Il était très conventionnel. Rien n’était léger avec lui. Moi, je suis un jouisseur, la légèreté fait partie de ma conduite de vie. Cela n’empêche pas l’esprit de sérieux. Je me suis révolté contre lui, ça a été très violent, il y a même eu de la haine de ma part, pas de la sienne. Je voyais qu’il m’aimait, mais j’avais beaucoup de mal à le lui rendre. Par la suite, nous sommes parvenus à construire notre relation d’adultes.
Normale Sup, agrégation de philo… vous étiez un élève modèle. Aimiez-vous l’école ? Je l’ai abordée, comme le reste de ma vie, sans en perdre une seconde. J’étais très attentif. J’ai fait des études parce que j’écrivais bien. Je suis devenu professeur de philo. J’ai enseigné pendant cinq ans et j’ai adoré cela. Je vois toujours mes anciens élèves. La philo, ce n’est pas transmettre un savoir, mais la liberté. Je leur donnais la boîte à outils pour penser et leur disais : «Ne dites pas ce que je dis, ne pensez pas ce que je pense, mais réfléchissez par vous-mêmes.»
Qu’est-ce qui vous fait arrêter l’enseignement ? Le fait que je gagne immédiatement ma vie avec mes droits d’auteur. Cela m’est tombé dessus, c’est allé très vite ! Ma première pièce de théâtre (La Nuit de Valognes), en 1991, se passe bien, et la deuxième (Le Visiteur,1993 ) remporte un grand succès. Je découvre que j’ai cette chance de pouvoir vivre de ma plume et de consacrer mon temps à l’écriture. Mais je ne suis pas téméraire. Je prends d’abord une année de congé, puis une deuxième… et, à la cinquième, on me demande de démissionner, ce que je fais, car je suis déjà joué dans de nombreux pays. Je n’ai pas fui l’éducation nationale, j’ai rejoint un autre type de vie.
Un autre type de vie lié aussi à « l’événement » que vous vivez une nuit de février 1989, dans le désert du Hoggar [en Algérie]. Il représente, dites-vous, « une seconde naissance ». Oui, c’est une seconde naissance. J’avais 28 ans. Ma première pièce commence à circuler et on me demande d’écrire un scénario sur Charles de Foucauld [un officier de cavalerie français devenu religieux catholique et ermite]. C’est pour cela que je pars dans le Hoggar, sur ses traces. Je suis dans un groupe de dix personnes, très diverses, et le voyage consiste en une marche d’une dizaine de jours en couchant à la belle étoile, de Tamanrasset jusqu’à l’ermitage de Charles de Foucauld, sur le plateau de l’Assekrem. Un jour, lors de l’ascension du mont Tahat, arrivé au sommet, je suis exalté par ce que je vois. Je lance: «Je passe devant, je descends en premier. » Mais je n’ai aucun sens de l’orientation ! Je dévale, au bonheur de marcher et, arrivé en bas, je ne trouve pas le campement. Il est 19 heures, la nuit va tomber, je suis perdu, je n’ai qu’une petite gourde, je suis habillé d’un short et d’un teeshirt, et le vent se lève.
Avez-vous peur sur le moment ? C’est une peur assez abstraite. Une phrase me traverse l’esprit : « On met trois jours à mourir de soif. » J’appelle, mais personne ne me répond. Je crains de passer une nuit horrible. Je me protège du vent, je m’ensable légèrement, et puis… je passe la plus belle nuit de ma vie ! Une nuit mystique, une « nuit de feu », comme disait Pascal, c’est-à-dire une nuit où je vis une extase, au sens littéral. Je me dédouble, je sors de moi-même et vais à la rencontre de la chaleur et de la lumière. J’y vais tellement que je m’y fonds et que j’y disparais.
Est-ce une hallucination ? On pourrait le penser. En fait, la chose inouïe est qu’on reste libre en face d’une révélation. On peut l’accepter ou la négliger. Si on veut la refuser, on sert toutes les thèses réductionnistes. Sion l’accepte, on change.
Et avez-vous changé ? Oui. Il y a un vrai travail alchimique qui s’est fait en moi après cette nuit et qui m’a totalement modifié. Je ne sais rien de plus, mais je crois. La condition humaine demeure un mystère, mais j’ai cessé d’habiter le mystère avec angoisse, je l’habite avec confiance. La confiance, c’est une petite flamme qui n’éclaire rien, qui ne dispense aucun savoir, mais qui tient chaud.
Après cette nuit mystique, quand avez-vous retrouvé votre groupe de marcheurs ? Trente-deux heures plus tard. Au matin, le soleil se lève, je comprends alors que je suis du mauvais côté de la montagne. Je passe ma journée à la remonter. En fin d’après-midi, je la redescends et, là, le guide touareg m’aperçoit et vient à ma rencontre. Il m’a pris dans ses bras. Pendant que je me lovais dans la félicité, ils avaient passé une nuit d’angoisse. J’ai presque ressenti mon secret comme une obscénité. Je ne pouvais pas leur dire que ça allait mieux que jamais.
Vous avez mis beaucoup de temps avant de raconter ce « secret ». Oui, parce qu’une révélation, c’est une révolution. J’ai gardé pour moi cet événement intime. Puis je l’ai raconté à mes parents.
Quelle a été leur réaction ? Beaucoup d’envie et de jalousie chez mon père, qui est un athée douloureux. Ma mère a été ébranlée. Ce n’était pas une grande amoureuse des spiritualités. Elle était très méfiante envers les religions, j’ai eu une éducation très athée. Après le Hoggar, on a beaucoup parlé de ces choses-là. Elle avait quitté l’athéisme pour un agnosticisme ouvert.
Mais pourquoi, quelques années plus tard, décidez-vous de rendre publique cette expérience ? Des lecteurs et des journalistes me harcèlent en me demandant : d’où vient cet optimisme qui est en vous ? Comment pouvez-vous raconter des choses épouvantables sans jamais éteindre la lumière ? J’ai fini par craquer. Un jour, j’ai répondu : parce que j’ai la foi. Mais je reste autant philosophe que croyant, car croire et savoir sont des choses distinctes. Je ne peux pas transmettre ma croyance, je peux juste en témoigner.
Est-ce cette « deuxième naissance » qui fait de vous l’écrivain que vous êtes ? Bien sûr. Ce qui me donne le droit de tout interroger et de parler de choses graves, c’est de toujours y chercher, aussi, la lumière. On m’a fait un cadeau extraordinaire en me mettant au monde. Je ne suis pas un écrivain croyant, je suis un écrivain confiant.
Et pourquoi tant écrire ? Et encore, je me retiens, car c’est ingérable pour mon éditeur ! Je suis un curieux sur pattes. Un curieux de tout : des spiritualités, des civilisations, des façons d’aimer et de désaimer… Et cette curiosité se transforme assez vite en histoire. J’ai l’impression d’avoir un verger dans la tête, avec des arbres qui portent des nouvelles, d’autres des contes, des romans, des pièces…Et je vais voir régulièrement ce qui est mûr. Je mourrai sans avoir accouché de toutes mes histoires. C’est certain.
Faut-il voir dans cette boulimie d’écriture un sentiment d’urgence ? Oui. Très net. C’est générationnel. Si on prend la photo de ma promo à Normale Sup en 1980, il y a plein de morts. Filles et garçons. J’ai vécu ces moments d’accompagnement dans la maladie, dans la mort. Alors, si j’ai le privilège odieux de vivre, je ne dois pas en perdre une seconde. Mais il n’y a rien de triste là-dedans. Les anciens disaient : « Toujours se rappeler qu’on est mortel. » J’ai envie de dire ça dans le langage d’aujourd’hui : « Toujours se rappeler qu’on est vivant. »
Quand des lecteurs ou des spectateurs vous disent : « Vous nous racontez des histoires qui nous font du bien », est-ce une formule que vous aimez ? C’est le plus beau compliment. Mais je ne l’ai pas compris tout de suite. Cela signifie : vous m’avez apporté quelque chose, vous m’avez aidé à traverser une difficulté. Pour moi, dans la littérature, il y a la dimension du soin. Lire aide à vivre. Mais je comprends totalement qu’être dans les listes de best-sellers peut créer une méfiance systématique de la critique. Moi-même, quand je regarde ces listes, je n’en trouve qu’un ou deux de valables. Mais, comme tout ce qui est systématique, c’est sot! Je l’ai vécu : à 4000 exemplaires j’étais un génie, à 40 000 j’avais du talent, à 400 000 j’étais une merde ! Pourtant je suis toujours le même !
Et vous, quels sont les auteurs qui vous ont fait le plus de bien ? Le premier, c’est Alexandre Dumas : il m’a fait aimer la lecture, sinon la littérature. Puis Colette par son éveil sensuel, sa liberté sensorielle, au plus proche des choses, sans jugement idéologique. Je me ressource régulièrement à Colette. Et puis Julien Green, pour l’exploration de l’intériorité spirituelle ou amoureuse. Et, évidemment, il y a deux grands chocs, deux « tueurs » en littérature : Proust et Dostoïevski. Quand on les lit, on pose la plume en se disant : ce n’est pas la peine ! Et puis il y a Diderot. Etudiant, je lui ai consacré ma thèse. Je ne pense rien comme lui, mais c’est mon maître d’enthousiasme, de curiosité et de liberté.
Dans votre livre, vous racontez avoir voulu vous suicider, en vous jetant d’un bateau, quelques mois après le décès de votre mère. C’est surprenant pour quelqu’un qui dit aimer la vie… Tout optimiste sait parfaitement ce qu’est le pessimisme, parce qu’il l’est à 10-20%. Et inversement. Moi, l’amoureux de la vie, j’ai parfois tellement souffert que j’ai eu envie de la quitter. Sur ce bateau, où j’étais allé si souvent avec ma mère, je ne voyais que ce qui me manquait, je n’arrivais pas à sortir de ce chagrin. Mais, finalement, je n’ai pas sauté. Maintenant, je peux enfin dire que j’ai survécu à son départ.
Sandrine Blanchard
FNAC - « Ce roman-monument est un hymne à l’amour »
Avec Journal d’un amour perdu, nous sommes loin d’un simple roman de rentrée littéraire. Ici, Éric-Emmanuel Schmitt se donne à nous. Impossible de lire ces 251 pages sans ne rien éprouver, sans avoir l’impression de vivre pendant un temps ce que lui-même a vécu… L’expérience du deuil mais, avant celui-ci, l’expérience de la perte.
« Maman est morte ce matin et c’est la première fois qu’elle me fait de la peine. »
C’est ainsi que commence le dernier livre, Journal d’un amour perdu d’Éric-Emmanuel Schmitt. Consignant pendant deux ans dans un journal ses pensées, aussi fragmentées que son être depuis l’annonce du décès de sa mère, il livre par des mots justes et sincères la voie du chemin, du heurt à l’apaisement.
Comment continuer à vivre ? Comment même avoir l’envie de vivre ? « L’Irrémédiable est à la fois ce qui me déchire et ce qui me contient » écrivait Roland Barthes dans son Journal de deuil et c’est aussi ce qui semble maintenir Éric-Emmanuel Schmitt qui n’a plus à souffrir à l’idée de la perte de sa mère car, enfin, l’événement fatal est arrivé.
Ce roman-monument est un hymne à l’amour érigé par un fils pour sa mère. Autant qu’un journal de deuil, c’est un journal de renaissance offrant l’horizon d’une vie à venir, à travers elle mais sans elle. Et durant ce long combat où il réapprend à vivre, non plus pour deux mais pour lui-même, il arrose d’amour le tombeau de son père décédé qu’il redécouvre autrement.
« Me voici. Elle a réussi. Après son départ, Maman m’offre donc un cadeau : elle me restitue un père, mon père, l’amour de mon père, l’amour pour son père. »
Et parce que chaque phrase se couple à une autre, nous pouvons savourer avec plaisir le cercle fermé que forme la première et la dernière phrase du journal.
« Maman est morte ce matin et c’est la première fois qu’elle me fait de la peine. »
« Maman est vivante ce matin, et ce n’est pas la dernière fois qu’elle me donnera de la joie. »
Anastasia
La Presse (Canada) - « Éric-Emmanuel Schmitt : le deuil comme chagrin d’amour »
Aspiré par le chagrin au moment de la mort de sa mère, qu’il chérissait, Éric-Emmanuel Schmitt s’est raccroché à la vie grâce à l’écriture. Son touchant Journal d’un amour perdu montre son retour progressif à la joie et la gratitude d’avoir aimé. Entrevue.
Journal d’un amour perdu dit tout de votre immense chagrin d’enfant, même si vous étiez déjà un homme de 57 ans à la mort de votre mère. L’ampleur de cette peine vous a-t-elle étonné ?
J’ai toujours aimé ma mère d’un amour total, mais d’un amour inquiet. Dès l’enfance, si elle arrivait en retard à la maison, je craignais qu’elle soit déjà morte… Pendant toute ma vie d’adulte, quand le téléphone sonnait à une heure qui m’était incompréhensible, je m’attendais toujours à ce qu’on m’annonce cette nouvelle qui allait me dévaster. J’ai vécu 57 ans en craignant ça et, un jour, c’est arrivé. Ça m’a complètement abattu. Moi qui suis le contraire d’un nostalgique et qui dévore le présent, tout à coup, je me suis réfugié dans le passé, dans les souvenirs – parce qu’elle y était. Je me suis réfugié dans ma tristesse, parce que c’est la forme qu’a prise mon amour pour elle, à ce moment-là. Ç’a été d’une force au point de m’ôter l’envie de vivre…
Ce journal est-il né d’une nécessité ?
Le jour de sa mort, le journal que je tiens de façon épisodique est devenu central dans ma vie. Je me suis mis à écrire tous les jours des phrases ou des pages. […] J’avais besoin de parler d’elle et je n’avais pas envie de me répandre auprès de mes proches parce que je n’arrivais pas à maîtriser mes émotions. Et aussi parce que j’ai un pouvoir dans la vie, celui de donner la vie par les mots. Je crois que j’en avais besoin instinctivement.
Ce livre parle du deuil. Or, en le lisant, on sent que ce récit ne sait pas qu’il sera un livre ni même qu’il fait partie d’un processus de deuil…
Il y a quelque chose d’organique, qui se vit au jour le jour. Un naufrage, d’abord, puis un attachement à la tristesse. […] Après sa mort, je ne voyais que son absence, le monde était donc vide. Peu à peu, il s’est rempli non pas de sa présence, mais de ses souvenirs. De mes souvenirs. Et c’est ça, guérir du chagrin : c’est donner un autre statut à ses souvenirs. C’est enrichir ce qui est présent de ce qui a été.
Il y a une forme d’impudeur dans ce livre. Est-ce la première fois que vous avez le sentiment de vous dévoiler à ce point ?
Oui, bien sûr, mais je ne suis pas d’accord avec le mot impudeur. L’impudeur, c’est ne pas savoir ce qu’on montre. Je crois savoir ce que je montre. Je ne me peins pas comme un héros. Uniquement à travers mes failles, mes fantasmes, mes idées idiotes concernant mon père, mes ratages et les grandes émotions que j’ai vécues, qui sont le vrai fil de ma vie. J’ai cru que ça me gênerait, mais je me suis rendu compte que cet exercice de liberté me libérait.
Vous écrivez que « la banalité du malheur ne le supprime pas ». Ce genre de phrase a aussi quelque chose de libérateur. Elle accorde la permission d’avoir mal, même si la source de notre chagrin n’est ni unique ni originale…
Ce que dit ce livre, c’est qu’il faut aller au bout de sa souffrance. Que c’est normal de souffrir. Qu’il ne faut surtout pas prendre de pilule pour ne pas souffrir. C’est un livre qui réagit à notre époque qui veut tout médicaliser. Il est normal d’être triste quand un être aussi extraordinaire que ma mère disparaît. Il fallait que j’aille jusqu’au bout de cette tristesse, voir ce qu’elle ferait de moi. Il faut accepter l’intensité des sentiments, se fabriquer avec, qu’il s’agisse de l’amour ou de la perte de l’amour, de la joie ou de la tristesse.
Recevez-vous beaucoup de confidences de vos lecteurs depuis la sortie de ce livre ?
Des confidences incroyables ! Y compris de journalistes ou de patrons de presse que je croyais réduits à leur fonction et qui, tout d’un coup, me parlent très humainement. D’eux-mêmes et de leurs désarrois. Ça fait du bien. J’ai bien fait de montrer mes cicatrices. Du coup, les autres peuvent me montrer les leurs et tout le monde se sent mieux. On arrête la comédie de la force. On arrête la farce qui consiste à croire qu’on est tous des héros. […] Les failles ne nous séparent pas, elles nous rapprochent.
Alexandre Vigneault
Le Soir (Belgique) - « Émouvant et juste. »
Le jour où sa mère est décédée, Éric-Emmanuel Schmitt a perdu tous ses repères. Désemparé, en colère, fou de tristesse, il lui a fallu du temps pour lutter puis apprendre à vivre avec cette douleur au quotidien. Il raconte son « devoir de bonheur » envers cette femme qui lui a tout donné : la vie, la passion de la culture et des arts, le sens de l’humour, la joie d’exister, un amour infini… Émouvant et juste.
Écrire ce livre aura été un long cheminement qui vous a permis de faire le deuil? Je pense qu’écrire mon journal intime, qui n’avait pas de vocation publique à la base, m’a beaucoup aidé dans une période de désarroi extrême. Mettre en mots ses sentiments, c’est avoir une prise sur eux. Formuler sauve ! J’ai toujours tenu un journal intime de manière épisodique et cela s’est accentué à la mort de ma mère. Je discutais beaucoup avec elle et quand cela s’est interrompu, j’ai ressenti une violence infinie. J’ai reçu le don de pouvoir donner la vie grâce aux mots, j’ai donc commencé à écrire pour lui redonner vie. Après un an et demi, j’ai compris que je ne vivais pas une errance comme je le pensais, mais bien un cheminement qu’on appelle deuil. On passe par la stupéfaction, la tristesse, la reconstruction et puis la reconquête de la joie. Si j’ai écrit pour moi au départ, j’ai ensuite voulu partager cela pour aider les autres. Je voulais témoigner du fait qu’il est possible d’être très malheureux puis à nouveau heureux.
Est-ce que cela a été difficile de publier un livre aussi personnel ? Oui, j’ai eu très peur même. J’ai raconté ici des éléments parfois crus de la vie, alors que je suis très pudique. Mais j’ai su le rester même en me dévoilant, car l’impudeur est de ne pas savoir ce que l’on montre. Si cela a été difficile, c’était nécessaire. Je suis un écrivain de l’imagination et sur environ 45 volumes, c’est seulement le troisième personnel. J’ai choisi le « je » pour donner du poids à mes propos. Ce livre raconte la perte d’un amour maternel mais aussi la recherche et le rétablissement d’un amour paternel… C’est vrai, oui. Entre ma mère et moi, l’amour était facile et naturel, c’était un long épanouissement, alors qu’entre mon père et moi, cela a toujours été difficile et contrarié, comme un chemin bordé de précipices. Ce livre est donc un hommage à l’amour, même celui qui est difficile. Moi j’ai retrouvé l’amour de mon père dans mon passé et j’ai compris certains événements avec le recul. On voit toujours le passé par le prisme du présent, on a donc plusieurs passés en fonction de celui que l’on est aujourd’hui.
Vous évoquez à plusieurs reprises un « devoir de bonheur » envers votre maman…Oui car elle m’a fait le cadeau de la vie belle. Maman avait un amour de la vie infini car elle était curieuse, enthousiaste, vive, amoureuse des arts… Quand on a le privilège de la vie, il faut la savourer et goûter la mélodie des jours. Elle n’aurait pas supporté de voir son fils mélancolique et désespéré. Je savais donc qu’au début, j’étais un mauvais élève de ce « devoir de bonheur ». Mais il faut décider d’être heureux pour pouvoir l’être. J’ai sombré et touché le fond, j’ai même eu envie d’en finir, puis j’ai rebondi car le corps est plus intelligent que l’esprit, il est toujours du côté de la vie. Ce qui compte n’est pas le but mais bien le cheminement.
Éloïse Dewallef
La Libre Belgique (Belgique) - « Éric-Emmanuel Schmitt : “Ma maman, mon amour »
Le Journal d’un amour perdu est un récit où Éric-Emmanuel Schmitt livre un peu de son intimité, de son enfance, du rôle capital qu’a joué sa mère tout au long de sa vie et des rapports bien plus compliqués qu’il eut avec son père. L’auteur de tant de livres qui furent des best-sellers mélange ici la pudeur qui demeure et le récit de scènes parfois très personnelles, qui sont au cœur de sa vocation d’écrivain. Un récit qui est une forme de travail du deuil que tout homme doit accomplir à la mort de ses parents.
Vous commencez ce journal d’un deuil par une phrase qui ressemble au début de “L’Étranger” de Camus : “Maman est morte ce matin”. C’est un clin d’œil à Camus, dont je suis fan. Mais mon livre porte sur l’attachement alors que son roman parlait du détachement.
La mort de votre mère a dû être culpabilisante. Vous l’avez retrouvée dans son appartement à Lyon, morte depuis plusieurs jours. La mort est obscène quand le corps perd toute dignité avant qu’on tâche de la maquiller par des cérémonies. Le corps n’est alors plus la personne. Et moi, qui vivais avec elle depuis toujours un amour fusionnel, je m’en suis voulu de ne pas avoir senti sa mort venir. Je critiquais ceux qui avaient ainsi oublié leurs morts ; je ne les juge plus désormais.
Une mère morte c’est le double mystère de la naissance et de la mort. C’est la chair qui m’a donné la vie et la chair qui perd la vie. J’ai eu la chance immense d’avoir une vraie mère, une mère aimante. Ma vie est un tissu d’émotions et c’est elle qui me les a offertes : le théâtre, la lecture, tous les piliers de ma vie. Elle a toujours eu sur moi ce regard bienveillant qui me disait : “Tout est possible si tu travailles.” Ce qui me manque d’ailleurs n’est pas une mère, mais c’est elle.
Qu’est-ce qui a changé désormais en vous ? Je ne suis plus l’enfant de personne mais j’espère être encore un enfant. Une vie réussie c’est un adulte qui donne ses moyens aux rêves de l’enfant en lui. L’avenir désormais n’est plus un horizon qui recule sans cesse quand je m’en approche. Mon rapport au temps a changé et il me faut plus que jamais en faire quelque chose d’utile.
Votre mère fut votre fan totale. Vous écrivez pour être aimé d’elle ? Pas du tout. Je suis habité par le désir de rejoindre l’Autre dans quelque chose de lumineux qui m’aide à vivre. Même si mon nom disparaissait de mes livres, je resterais fou de bonheur de pouvoir encore donner ça aux autres.
D’autres évoquent leur enfance comme terreau de leur vie d’écriture, voyez Yann Moix… Avant de parler de soi, il faut avoir le but de parler à l’Autre de lui, de nous, de lui tendre un miroir. La livre est un lieu où on réfléchit dans les deux sens du terme. En 45 textes, ce n’est ici que le troisième où j’évoque ma vie, après La nuit de feu et Ma vie avec Mozart.
Ce livre est un journal. Un journal réécrit du chemin parcouru pendant deux ans depuis la mort de ma mère au printemps 2017. C’est au bout de celui-ci que je vois comment cette errance a changé mon rapport aux souvenirs d’elle. Dans le livre, il y a deux descriptions de Lyon. Celle après sa mort, quand la ville est vide de ma mère. Et plus tard, quand la ville est devenue un trésor, car remplie des souvenirs de ma mère.
Vous évoquez l’idée du suicide, qui vous est venue lors d’une croisière littéraire. Curieux pour un optimiste perpétuel comme vous. Un optimiste sait ce qu’est le pessimisme. Je suis un homme volontaire et actif et je voulais prendre le dessus sur ma souffrance par un suicide. C’est mon corps qui fut plus résilient en me rendant comme hypnotisé face à la mer. Et je me suis souvenu de la volonté de ma mère qui me répétait qu’on avait un devoir de bonheur.
Autant vous aimiez votre mère, autant ce fut compliqué avec votre père. Situation très œdipienne. Quand il m’a vu naître avec un bec-de-lièvre, il a cru que je n’étais pas normal et sans cesse il a pensé que mes bonnes notes à l’école et l’université ne pouvaient être normales pour quelqu’un comme moi. Mon père m’aimait, mais à sa manière, maladroite. Il m’a fallu du temps pour retrouver mon père au moment où je perdais ma mère.
Vous racontez même que vous avez pissé dans ses bouteilles d’alcool et ne le lui avez dit qu’une fois bues. Je voulais lui faire honte de boire.
Vous étiez sûr qu’il n’était votre père ? Vous voyez ma tête, elle est bien loin de la sienne. Lui, il était Paul Newman. J’ai cherché le secret de ma naissance et il a fallu du temps pour que j’admette qu’il était mon père. C’est très œdipien de vouloir être le seul amour de ma mère.
Votre foi vous a-t-elle aidé ? Nullement. Le manque est là et la foi rend la disparition de l’autre encore plus cruelle, nous laissant perclus de questions : où est celle que j’aimais tant ?
Mais la mort est un scandale. Pas du tout, elle fait partie de la condition humaine et est nécessaire, même si la mort des autres fait si mal. Ma foi ne m’aide pas à répondre à cela. Ma foi c’est la confiance dans le mystère, dans ce qui m’échappe
Guy Duplat
Journal de Montréal (Canada) - « Le devoir du bonheur »
Pendant deux ans, Éric-Emmanuel Schmitt s’est coupé des siens, noyé dans le travail, et ne s’est livré qu’à son journal intime. Bouleversé par le décès de sa mère, avec qui il avait tissé des liens extrêmement forts, il a lentement remonté la pente, apprivoisant le chagrin et la perte. Il raconte cette épreuve dans un livre bouleversant, rempli de confidences : Journal d’un amour perdu.
Il y a deux ans et demi, le décès soudain de la mère d’Éric-Emmanuel Schmitt, alors que tous ses proches la croyaient dans un établissement de cures thermales où elle avait ses habitudes, a complètement bouleversé l’écrivain et les membres de sa famille.
À travers le journal de cette épreuve, qu’il raconte avec une éloquence et une vérité sans fard, il partage des moments de son enfance et de son adolescence. Il raconte sa passion pour le théâtre, révèle aussi sa relation difficile avec son père et ses questionnements par rapport à sa naissance.
Pendant qu’il présidait le Salon du livre de Québec, l’écrivain était très inquiet pour sa belle-fille, Coline, gravement malade. À Montréal, tout juste opéré pour une blessure au genou (une chute provoquée par de la glace noire), il est monté sur scène.
Devoir de bonheur
Eric-Emmanuel Schmitt, convaincu qu’il a un « devoir de bonheur », a entrepris une longue et difficile bataille contre la déprime, apprivoisant le deuil un jour à la fois. Pour rendre hommage à sa mère, Jeannine, une femme énergique et lumineuse qui a présenté des danses baroques françaises pendant l’Expo 67, il a choisi la renaissance.
« Il n’y a pas moyen de se préparer à cette chose-là. On ne sait pas comment on réagira, et c’est un moment d’immense bouleversement intérieur », commente-t-il, en entrevue.
« C’est ce que je raconte dans mon journal : apprendre à avancer sans quelqu’un qui vous donne autant d’amour, qui vous a fait aimer la vie, et se rendre compte qu’on n’aime plus la vie alors qu’on a le devoir de l’aimer. On a un devoir de bonheur. Ma mère voulait que je sois heureux, donc elle n’aurait pas supporté le désastre intérieur que j’ai éprouvé à son départ. »
L’optimisme, malgré tout
Il a dû faire la lente reconquête de l’équilibre et la lente reconquête de la joie. « Je suis un optimiste. Je pense que la joie est là, mais qu’elle est sous des couches de tristesse, d’inquiétude, d’angoisse. »
La joie est revenue parce que le « statut des souvenirs a changé, dit-il. « Avant, les souvenirs de ma mère rendaient le monde vide : je ne voyais que son absence. Mes souvenirs m’empêchaient de vivre le présent. À la fin du livre, je raconte que, maintenant, les souvenirs ajoutent des pages. C’est un trésor que j’ajoute à mon expérience du monde. Le monde est encore plus plein, alors qu’après son départ, il était totalement vide. »
Les cadeaux
Il a vécu deux ans de repli sur lui-même. « C’est très long, et on doute d’en sortir. On se dit : ça va être comme ça maintenant jusqu’à la fin de mes jours ? D’où des volontés suicidaires. C’est insupportable de souffrir autant. Et en même temps, je pensais toujours à elle et à son rapport avec son père – donc mon grand-père. Elle avait su être heureuse, être avec nous. Je me disais que c’était une épreuve, mais je restais optimiste. »
Pour se reconstruire et enfin vivre heureux, l’écrivain a tenté de faire vivre tout ce que sa mère disparue lui a apporté, comme l’amour du théâtre. « Je ne suis jamais monté autant sur scène que ces deux dernières années, parce que ça me faisait du bien. J’ai essayé de vivre tous ces cadeaux : l’amour de la littérature, des animaux, de la vie, des voyages. »
Marie France Bornais
Ilico (Belgique) - « Journal d'un amour perdu »
Dans Journal d’un amour perdu aux Editions Albin Michel, Eric Emmanuel Schmitt parle de sa mère disparue. Il ne s'y attendait pas: "Elle avait 87 ans, j’étais persuadé qu’elle serait centenaire. Dans les jours qui suivaient, je me suis caché. Je ne suis pas sorti. Je ne suis plus allé au Goncourt. Je ne pouvais pas donner le change. Je ne le dis pas, mais je me suis ôté de toute vie publique pendant un mois parce que je n’avais plus le courage de dire pourquoi", nous confie-t-il lors d'un entretien à Bruxelles.
Il fait alors face à une solitude sans nom. "C’est une autre solitude qu’on découvre. C’est pas qu’il n’y avait plus d’amour pour moi", admet l'auteur à succès. "C’est qu’il n’y avait plus cet amour-là. Ma mère n’est pas le seul amour de ma vie. Mais je peux quand même dire que c’était le plus fort. Mais… Mais… Mes proches ont senti qu’on a beau aimer terriblement l’autre, on ne peut pas l’aider. L’amour ne donne pas de pouvoir. L’amour ne donne pas la puissance. L’amour, il n’a pas ses limites comme amour. Mais il a ses limites dans la réparation du réel."
"Le masque du bonheur, ce n’est pas un mensonge. C’est une vérité en avance"
Il poursuit: "J’ai connu des tas de deuils dans ma vie. Je crois que l’amour fusionnel, il était vraiment exceptionnel. On en a toujours eu conscience, ma mère et moi. Et elle a eu tellement de conflits avec mon père à cause de cet amour fusionnel. Mon père avait parfois du mal à trouver sa place. Sa place, et vis-à-vis d’elle et vis-à-vis de moi, parce que de toute façon, il sentait qu’il y avait un truc plus fort que tout, auquel il n’avait pas droit. Il ne pouvait pas y toucher! (Rires). Donc forcément il y a une jalousie d’homme et de père. Il a eu les deux. C’est comme ça la vie."
Eric-Emmanuel Schmitt n'a rien senti arriver, lui si "fusionnel" avec celle qui l'a mis au monde. “Quand j’apprends sa mort, mon premier réflexe est de m’inquiéter pour elle. Après, j’ai ma propre tristesse. Mais surtout une déflagration: j’aurais dû le sentir. Comment ai-je pu me lever, être de bonne humeur et regarder le printemps dans le jardin. Me préparer un belle journée d’écriture, comme j’aime et ne pas le sentir. Ça, ça a été difficile. On était tellement fusionnels que je sentais à distance ce que je sentais, comme elle sentait à distance ce que je ressentais. On était liés, quoi. Au bout de l'enquête de sa mort, je prends mon carnet et que je découvre qie le mardi où c'est arrivé. J'étais à Paris et que j'étais dans l'écriture, qui est le lieu où je suis sensible. J'avais senti les choses. Parce que dans la vie on se protège, dans l'écriture, on ne se protège pas. C'était rassurant. Je me souviens très très bien de cette journée, c'était éperdu."
Journal d'un amour perdu, c’est réellement votre journal?
“C’est mon journal réécrit. A la mort de ma mère, je me suis réfugié dans mon journal. Il a pris beaucoup plus de place que dans le reste de ma vie. Parce que j’avais besoin de parler d’elle. J’avais aussi, je pense, besoin de lui redonner vie par l’écrit. Or, c’est une des rares choses que je sais faire: donner la vie avec les mots. Je fais ça depuis des années. Parce que je me réfugiais aussi dans mes souvenirs. Ce n’était pas destiné à être publié. Après un an et demi, j’ai vu qu’il y avait un trajet qui se dessinait. Un trajet qui allait de la tristesse vers la reconquête de la joie. Je me rendais compte que j’étais en train de lui obéir, c’est-à-dire de respecter le devoir de bonheur. Elle voulait que je sois heureux et n’aurait jamais supporté de me voir dans l’état où j’étais après sa disparition. Et à ce moment-là, je me suis dit: ça j’ai envie de le communiquer aux autres. Parce que je sais ce que c’est le grand amour accompli, et j’ai pensé que je ne m’en remettrai pas. Et puis finalement, je découvre qu’on peut s’en remettre. J’ai réécrit. Mon journal intime est devenu la matière d’un livre qui, lui, est adressé aux autres.”
N’est-ce pas plus difficile de partir de sa matière personnelle?
“Oui. Et en même temps, ce deuil m’avait tellement bousculé qu’il me rendait extrêmement honnête. Je trouvais une pureté dans l’honnêteté, quelque chose que je devais lui rendre, à elle. Moi qui suis très pudique, tout d’un coup, je me sentais comme un devoir de vérité. J’étais moi-même surpris. C’est mon 46e volume, pièces de théâtre comprises. J’ai fait toute ma vie avec mon imagination, à part “La nuit de feu” qui raconte mon expédition dans le désert et “Ma vie avec Mozart”. C’est mon troisième texte qui est autobiographique. Je sentais qu’il fallait partager tout ça avec la plus grande justesse.”
Vous évoquiez ce cheminement de vos souvenirs passés vers votre bonheur. Mais vous vous décrivez comme étant un homme du présent… Ce chagrin vous a vraiment plongé dans les abysses d’une tristesse sans nom. Il fallait en toucher le fond pour remonter?
“Oui, je suis un homme qui vit au présent et, tout d’un coup, à sa disparition, je suis devenu mélancolique. Nostalgique, je me réfugiais dans le passé. Pourquoi? Parce qu’elle y était. Le présent me paraissait vide. C’est vraiment épouvantable de se lever en pensant que le monde est vide et de ne pas avoir envie de vivre sa journée. Je suis le contraire d’un mélancolique et nostalgique. Et en plus, j’aimais ma tristesse parce que c’était la nouvelle forme de notre amour. Donc je chérissais ma tristesse, je la cultivais. C’était mon chez-moi. Le dernier chez moi que j’avais envie d’habiter. Et, en même temps, une partie de moi luttais contre ça. Je me disais qu’elle aurait détesté de me voir comme ça. C’est ce que j’appelle mon devoir de bonheur. Elle m’avait élevé comme ça: profiter de la vie, jouir de la vie, savourer chaque instant… Je savais qu’il fallait que je me relève. Mais sans doute, comme vous le disiez, il fallait que je sombre pour toucher le fond et remonter.”
Vous avez vraiment été loin. Sur un bateau de croisière, vous avez même pensé à en finir…
“C’est le moment crucial. Heureusement mon corps est plus intelligent que moi! Il est moins précipité que ma volonté. Mon corps, lui, ne bouge pas. Il se laisse hypnotiser par les flots et se rendort. A partir de là, la reconstruction commence. Je recommence à m’ouvrir à la musique, à la beauté de ce que je découvre. L’envie d’écrire renaît. Les projets reviennent. C’est accidenté, hein. C’est les montagnes russes, mais quelque chose est reparti. Je me suis rendu compte que je ne l’avais pas fait et donc maintenant, il fallait vivre.”
Vous disiez que vous vous complaisiez dans cette tristesse parce que votre maman faisait partie de ce passé-là. Pas vraiment vrai puisqu’elle a semé des cailloux et, de la sorte, faisait encore partie de votre présent.
“Ca, ça m’a à la fois bouleversé et beaucoup aidé. Comme un Petit Poucet, elle avait laissé des cailloux. Elle avait dit aux gens que j’avais rencontrés et qu’elle connaissait, qui étaient proches de moi ou qui m’aimaient vraiment; Elle leur avait délivré des messages à me transmettre. C’était toujours: “prends soin de toi!’ Et donc, ben voilà, il fallait que j’obéisse parce qu’au fond, elle était toujours là au travers de ces personnes. Fallait se reconstruire."
Vos sourires, aujourd'hui, ça n'est plus "pour donner le change", faire croire que ça va ?
“Non. Le masque, ce n’est pas un mensonge. C’est une vérité en avance (Rires). C’est à dire que le masque du bonheur, de la jovialité, de la bonne humeur, j’ai fini par le rejoindre.”
- Journal d'un amour perdu, Eric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel.
Michel Marteau
Le Soir (Belgique) - « Emouvant, juste et revigorant. »
La mère d’Eric-Emmanuel Schmitt meurt. Et l’écrivain s’effondre. « Journal d’un amour perdu » est l’histoire de cet écroulement et de sa reconstruction.
Maman est morte ce matin et c’est la première fois qu’elle me fait de la peine. » C’est la première phrase du livre. Eric-Emmanuel Schmitt est atteint. Profondément. Depuis 56 ans qu’elle l’a mis au monde, ils allaient ensemble, ils rayonnaient à deux, ils s’éclairaient le chemin l’un l’autre. Comment survivre après cet arrachement? Comment affronter les autres, la vie ?
Schmitt est inconsolable. Mais en même temps, il sait que sa mère n’aurait pas apprécié: c’est elle qui lui a donné le goût de la vie, le culte de la joie, la passion des arts. Alors, il tente de se recomposer. Et c’est le chemin qui va de l’effondrement à la reconstitution que raconte ce Journal d’un amour perdu. Emouvant, juste et revigorant. Jusqu’à l’ultime phrase du livre: «Maman est vivante ce n’est pas la dernière fois qu’elle me donnera de la joie.
C’est l’histoire d’une renaissance, votre livre ?
Oui, c’est un trajet. Au départ, je n’ai pas écrit un livre mais un journal, que je tiens de façon épisodique depuis tou- jours, mais le jour même de la disparition de ma mère, il a pris une grande importance: j’avais besoin de parler d’elle, de me replonger dans le passé, de mettre en mots ce qui me bouleversait. Mais au bout d’un an et demi, je me suis rendu compte que ces errements dessinaient un chemin, du choc, de la tristesse vers la lumière et la reconstruction de soi. Et ça, j’avais envie de le partager. J’ai alors repris la matière du journal pour en faire un livre adressé aux autres, pour raconter ces moments de manière fraternelle.
C’est une leçon de vie ?
Oui. Depuis tout petit, je redoute la mort de ma mère. Je l’ai pleurée mille fois. Elle était en retard, pour moi elle était morte. J’ai toujours eu l’amour in- quiet.
Un jour, ça arrive et les pensées qu’on éprouve ne sont pas nécessairement celles qu’on avait prévues. Avant d’arriver à mon chagrin, j’étais sur son désarroi à elle. Pendant plusieurs semaines, ce n’était pas une mère qui me manquait, mais elle, sa personne. Et puis après, c’est une mère parce que mon rapport au temps change, parce que je découvre que je suis seul devant la mort. Ça fait partie de la condition humaine et j’avais envie de mettre des mots là-dessus.
Malgré ces vicissitudes, la mort, les problèmes de santé de votre belle-fille, vous retrouvez votre optimisme. Vous aviez un devoir de bonheur à assumer ? C’est le cadeau de ma mère, pas seule- ment la vie mais la vie heureuse. Elle était gourmande de la vie, curieuse, tou- jours intéressée par ce qu’il y avait à dé- couvrir. J’ai poussé avec ça et j’ai pu en bénéficier. Elle m’a offert le théâtre, plein de choses. Il fallait que ma joie re- vienne parce qu’elle ne m’avait pas fait pour que je sois dans cet état-là d’effondrement. Devoir de bonheur, oui, mais entre ce que veut la volonté et ce que peut le cœur, il y a parfois un différé cruel. La souffrance était insupportable, c’était un arrachement. Ma volonté a même voulu ma mort, mais heureuse- ment mon corps est plus intelligent que ma volonté, et je ne l’ai pas fait. Et puis, à partir de là, il y a eu un processus de reconstruction. Je tenais à dire ça parce que les gens me présentent comme une espèce de colosse, un type qui réussit tout. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Je suis beaucoup plus friable, vulnérable. Tout d’un coup, baisser l’armure et dire que je suis d’abord fait de failles, de faiblesses, d’amour et d’amour inconsolé, et je me sens plus à l’aise. J’espère qu’il y a un bénéfice pour le lecteur mais il y a sans aucun doute un bénéfice pour moi.
Pendant cette période, l’écriture continue malgré tout à vous appeler.
J’ai deux bouées. L’écriture, qui me per- met d’être ailleurs, d’être le scribe de l’histoire et de mes personnages. Et puis la représentation théâtrale, parce que là, je ne suis que dans l’instant, je vibre avec les autres. Entre ces bouées, je vais régulièrement au fond de l’eau. Mais j’ai appris depuis à faire la planche.
Dans ce « Journal », vous vous mettez fameusement à nu. Vous êtes-vous senti impudique ?
Je ne sais pas ce qu’est la pudeur ou l’impudeur. Je sais ce qu’est l’indécence. Et je n’ai jamais voulu l’être. Je sais ce qu’est l’exhibitionnisme, et je n’ai ja- mais voulu l’être non plus.
J’ai simplement essayé d’être honnête. tout en maintenant de la réserve. L’honnêteté était de ne pas travestir les sentiments ni ce qu’il peut y avoir de cru dans une mort, parce que ce n’est pas moi qui suis cru, c’est la vie qui l’est, qui nous présente des choses obscènes à la gueule.
Et ça, je voulais aussi en parler : on a ça dans la tronche et on doit faire avec. On reste pudique quand on sait ce qu’on montre. Je crois que je suis resté pudique mais en même temps j’ai été franc.
Dans ce « Journal », il reste quelque chose du dramaturge, du romancier : le suspense sur les circonstances de la mort de votre mère, le secret éventuel de votre naissance.
Pour moi, un livre doit avoir une forme. Et je me suis rendu compte que la forme du journal me permettait tout : l’exposé le plus sincère de certains moments de ma vie, l’aphorisme, la dramatisation des choses. Alors, je les ai utilisés.
Aphorismes, précisément : le livre en est rempli.
Mon intimité spirituelle se forge tou- jours en aphorismes. Plus c’est compact, plus ça me donne à penser. Quand j’arrive à mettre ma pensée sous une forme condensée, elle peut m’accompagner. Je me sers aussi des aphorismes des autres pour accompagner ma propre vie. La vocation de ma formation de philosophe, c’est écrire, élaborer la phrase ou la pensée pour être utile à l’autre.
JEAN-CLAUDE VANTROYEN
Télé Loisirs - « La séparation »
Éric-Emmanuel Schmitt raconte avec émotion sa difficulté à surmonter le décès de sa mère et à apprivoiser l’absence de celle avecl aquelle il vivait un amour fusionnel. Il tente de soigner son mal de mère, percer un mystère autour d’un père énigmatique décédé huit ans plus tôt, et réapprendre à vivre.
L'Avenir - « Éric-Emmanuel Schmitt apprend à vivre sans sa mère »
Dans « Journal d’un amour perdu », l’écrivain raconte avec une totale franchise ses difficultés pour faire le deuil de celle qu’il aimait tant.
« Maman est morte ce matin et c’est la première fois qu’elle me fait de la peine », constate Éric-Emmanuel Schmitt en ouverture de son Journal d’un amour perdu. Cet événement est doublement traumatisant pour lui : à la perte de l’être le plus cher de tous, cette mère qui lui a fait découvrir le théâtre (grâce à Cyrano de Bergerac) et ne l’a jamais déçu, grâce à qui il a une « une belle vie », s’ajoute la stupeur de n’avoir rien ressenti le jour de son décès. Du moins le croit-il, car, en réalité, lorsque, fin mars 2017, son corps a été découvert sur le carrelage de sa cuisine, elle était morte depuis plusieurs jours. Au moment de sa chute fatale, il était en train d’écrire, en guise de suite à Mademoiselle Butterfly, la lettre d’un fils à sa mère qu’il aime éperdument, et qui se meurt.
« J’avais envie de partager ce chemin qu’on appelle le deuil », explique l'auteur ucclois. Il ne dissimule ni son insondable tristesse, qui se manifeste par des pleurs incessants, ni sa profonde solitude, qui le conduit au bord du suicide. « Je n’ai pas voulu faire croire que j’étais fort alors que je ne l’étais pas. Je me reconnais beaucoup plus dans cet aveu de faiblesse que dans une pose qui consiste à dire que tout va bien. »
Ce qui l’a « sauvé », c’est le travail. La fin de l’écriture du recueil de nouvelles La Vengeance du pardon, puis l’interprétation, devant des salles combles et enthousiastes, de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et de Madame Pylinska et le secret de Chopin : « Cela m’a permis de me remettre dans le présent, alors que j’étais devenu nostalgique et mélancolique, ce qu’en temps normal, je ne suis pas du tout. »
Ces deux ans que retrace fidèlement ce livre voient également la résolution d’une interrogation que se pose l’écrivain depuis l’adolescence, celle de l’identité de son père à qui il ressemble physiquement si peu et qui, jusqu’à ce qu’il remporte un prix national de composition française, a toujours relativisé ses réussites scolaires.
Aujourd’hui, tandis que « s’est éteint le petit garçon », l’adulte a gagné en sérénité. Tout en jouant à Paris, il se consacre pleinement à son activité de juré du prix Goncourt, dont la première liste a été divulguée hier.
Michel Paquot
Télépro (Belgique) - « Une généreuse leçon de vie. »
Quand sa maman meurt voici deux ans, c’est un effondrement. Éric-Emmanuel Schmitt est inconsolable. Férue de théâtre, de littérature et de voyages, fine mouche et lumineuse, sa maman lui allégeait la vie. Leur relation était fusionnelle et extraordinaire. Depuis l’enfance, son attachement si fort à sa maman s’était incarné d’ailleurs en une hantise de la perdre. Et ce jour-là a fini par arriver... Au fil des pages, l’écrivain nous plonge au cœur de sa tristesse. Il raconte en toute franchise les difficultés qu’il a éprouvées à faire son deuil. Écrire lui apportera le salut et vaincra la douleur. Il apprivoise petit à petit l’inacceptable. Et parvient, au final, à nous délivrer une généreuse leçon de vie.
Gael (Belgique) - « Journal d'un amour perdu »
Inconsolable après la mort de sa mère, le romancier s’est lancé dans l’écriture d’un journal. On y trouve la faiblesse d’un petit garçon abandonné et les mots d’un magicien capable de convoquer le passé.
Le meilleur endroit pour penser à elle�? Un théâtre. Elle adorait cet endroit où tout est possible.
Une raison de continuer à tenir un journal�? Comme je ne peux plus lui parler, je lui écris. Elle est là, puisque je m’adresse à elle. C’est faire mourir les êtres une seconde fois que de les oublier.
Un caprice d’enfant face auquel elle est restée ferme�? Lorsque, après 3�ans de cours, j’ai voulu arrêter le piano, elle m’a tenu tête�: «�On ne s’arrête pas à la première difficulté, sinon, dans la vie, on ne fait rien. Vouloir c’est facile, pouvoir c’est plus compliqué.�» Toute ma vie, je l’ai remerciée.
Une recommandation pour cette rentrée littéraire�? Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois. Un roman drôle et cruel.
©
La Croix - « Formidablement indiscret. »
Dans un livre formidablement indiscret, Éric-Emmanuel Schmitt raconte son immense chagrin après le décès brutal de sa mère.
Il faut une bonne dose de courage et de détachement de soi, lorsque l’on est mondialement reconnu, pour partager une période douloureuse de son existence. Dans ce nouveau livre formidablement indiscret, qui rejoint chacun dans l’intimité de sa relation à ses parents, Éric-Emmanuel Schmitt se livre comme il ne l’avait encore jamais fait.
L’ouvrage, ni vraiment un journal ni un roman, commence par le décès brutal de sa mère Jeannine, 87 ans, dans son appartement de Sainte-Foy-lès-Lyon. Une mère adorée, encore belle et alerte – ensemble, ils se rendaient au Festival d’Avignon chaque été depuis 1975 –, toujours en bonne santé – elle avait été championne de France en course de vitesse en 1945. « Ma mère était mortelle mais elle ne fut jamais mourante. »
Le sens de l’humour et de la joie
Dès son jeune âge, l’auteur a vécu rongé par la peur de perdre sa mère. « Elle ignora toujours à quel point je paniquais durant ses absences. Je ne redoutais pas de me retrouver orphelin, je craignais qu’il lui arrive un malheur », écrit-il. Si cette peur n’a désormais plus lieu d’être, Éric-Emmanuel Schmitt n’en reste pas moins inconsolable. Larmes, cafard, détresse intime… qui se somatise sous forme d’une douleur au genou droit qui l’empêche d’avancer pendant ces longs mois de deuil.
C’est de sa mère qu’il a reçu le culte des arts et du théâtre, de la littérature et de l’écriture, le goût des voyages et de la gastronomie, le sens de l’humour et de la joie : « Je ne suis pas seulement chair de sa chair, je suis esprit de son esprit. » L’auteur se dit surtout triste de n’avoir rien pressenti, lui qui se savait si proche de sa mère : « Mon aveuglement et ma surdité remettent en question ma conception de notre amour. »
Le travail pour sortir de la dépression
Un amour qui peut sembler trop possessif et exclusif, d’autant qu’il s’est accompagné, pendant toute l’enfance de l’auteur, d’un rejet viscéral de son père Paul – lui-même décédé il y a plusieurs années. Ce père, kinésithérapeute et sportif accompli, devenait professeur de judo pendant les étés familiaux dans le centre de loisirs de Beauvallon, dans le Var. Lors d’une séance de signatures à Strasbourg, l’auteur est justement abordé par deux anciens habitués de Beauvallon : « Nous avons des révélations, sur vous et votre père. Il faut absolument que vous le sachiez », lui lance ce couple. De fait, en vidant l’appartement lyonnais, l’auteur a retrouvé les fameux carnets intimes de sa mère : il les dévore, espérant y trouver des révélations sur ses origines.
Éric-Emmanuel Schmitt évoque aussi – ce qu’il fait rarement (1) – sa vie quotidienne en Belgique, entouré de ses trois chiens japonais, et ses multiples activités d’écrivain, de metteur en scène, de compositeur, de comédien – notamment pour ses représentations, à travers la France, de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran… C’est son travail qui l’aide à sortir de la dépression : outre La Vengeance du pardon (Albin Michel, 2017), il a écrit Félix et la source invisible (À vue d’œil), paru en début d’année. Un récit qui, curieusement, raconte la manière dont un petit garçon ressuscite sa mère dépressive.
(1) Il a évoqué sa vie dans Plus tard, je serai un enfant, recueil d’entretiens avec Catherine Lalanne (Bayard, 2017).
Claire Lesegretain
Gala - « Mets-toi toujours du côté de la vie »
Il entretenait une relation fusionnelle avec sa mère. L’écrivain raconte le tournant dans son existence qu’a représenté sa disparition. Un véritable hymne au présent. Rencontre.
Ce furent cinquante-sept années d’une conversation ininterrompue. Lorsqu’ils se retrouvaient dans le salon à Sainte-Foy-lès-Lyon, ou lorsqu’ils voyageaient ensemble, ça n’était qu’éclats de rire. Le reste du monde s’estompait. De fait, la disparition de Jeannine a laissé son fils, l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt anéanti. Son Journal d’un amour perdu (éd Albin Michel) qui détaille les étapes de ce deuil, n’a pourtant rien de déprimant. A l’instar de son auteur, il pétille. La faute à sa mère. “Mets-toi toujours du côté de la vie”, lui répétait cette pimpante professeure de sport qui a toujours fait l’admiration de son fils. “Elle s’intéressait à tout, était toujours dans la bienveillance, le mouvement. Rendez-vous compte, s’émerveille-t-il, ma mère a été championne de France de course de vitesse en 1945, et il a fallu vingt-cinq ans pour que son record soit battu.” Au moment de sa disparition à quatre-vingt-sept ans, l’écrivain ne se doute de rien. Il s’en veut de n’avoir rien perçu. Pourtant à l’instant où sa maman mourait, il écrivait une fiction: l’histoire d’une mère qui donne sa vie pour sauver son fils. La sienne, prévenante, malgré la fin brutale qui l’attendait, causé par un arrêt cardiaque, avait pris soin de déposer quelques cailloux blancs, à son intention, sur le chemin du deuil. Chantal, une lectrice de première heure, qui avait rencontré plusieurs fois Jeannine, fut ainsi chargée de délivrer de sa part ce message à son fils: “ Prends soin de toi. Ménage-toi. Ne te crève pas à la tâche. Pense à toi.”
On lui répète qu’il faut deux ans pour faire le deuil.
Éric-Emmanuel Schmitt confesse, que durant cette terrible épreuve la foi ne lui fut d’aucun réconfort. “Au contraire, cela a aiguisé ma douleur, je me demandais si elle avait peur là où elle était…” Ce regard intransigeant et tendre posé sur lui et qui l’avait jusque là porté, s’était éteint. Alors, à quoi bon avancer? Sa jambe le lâche d’ailleurs, et le fait boiter. La tentation du suicide le traverse lors d’une croisière. “ Ma pensée était fracassée man mon corps est resté du côté de la vie, se souvient-il. J’étais planté là, sans bouger, hypnotisé par les flots.”
Il raconte aussi la colère lorsqu’on lui répète à l’envie qu’il faut deux ans pour faire le deuil d’un être aimé. “Cela me scandalisait, assure-t-il. Au départ, on ne voit que ce qui nous manque, donc on ne voit plus rien. La tristesse, c’est le rapport au vide. Avec le temps on ajoute une couche de souvenirs, le monde prend du volume, enrichi du passé.” L’auteur a trouvé le salut dans l’action. Agenouillez-vous, et vous trouverez la foi”, disait Pascal. Pour moi ce fut: “Écris, joue, et tu retrouveras le bonheur. Je ne suis certes plus l’enfant de personne, mais je suis bien décidé à rester un enfant, en vivant pleinement le présent.” Des jours qu’il décline intensément sur les planches. Quel plus bel hommage à celle qui lui a instillé le virus du théâtre à l’âge de dix ans? “Ma mère nous avait déposés, ma soeur et moi, sur le perron du théâtre des Célestins, à Lyon, pour que nous assistions à une représentation de Cyrano de Bergerac. En sortant, je lui ai glissé: “Plus tard, je veux faire Edmond Rostand!”
Elle l’encouragea à rejoindre le club de théâtre du lycée, et vint, bien sûr, applaudir à Paris sa première pièce, La nuit de Valognes. L’ex-professeure fut, du reste, très fière de voir ce texte écrit par son fils, sujet au bac quelques années plus tard. Pour autant je redoutais son jugement. Elle me répétait volontiers que je ne devais pas me reposer sur mes facilités”, avoue cet dernier. Elle ne ratait jamais la première de ses créations. Il y a quelques jours, dans sa loge du théâtre Rive-Gauche, avant la représentation de Madame Pylinska et le secret de Chopin, Éric-Emmanuel Schmitt s’est surpris à chercher son regard. “Je l’ai trouvé dans le miroir. Plus ça va, plus je ressemble à ma mère. Moi qui déteste les miroirs…”
Candice Nedelec
PAGES ( Les livres par les libraires ) - « Un très beau texte qui va au-delà de l’intime. »
«Maman est morte ce matin et c’est la première fois qu’elle me fait de la peine. » C’est sur ces mots que démarre le journal de l’auteur au jour de la disparition de celle qui l’a mis au monde. Ce journal relate les deux ans qui ont suivi et tout l’amour d’un fils pour sa mère. Deux ans de souvenirs, d ’anecdotes, de chagrin et de vie. Deux ans d’émotions, de souffrances et de bonheur. Deux ans de va-et-vient entre rires et larmes. Car pour ne pas trahir celle qui lui a tout donné - le goût de la vie, de la joie, la passion pour le théâtre et pour les arts en général -, il «s ’essaye au bonheur»... toujours. Et, pris dans cette contradiction, larmes inconsolables de cette perte incommensurable et souvenirs de tant de bonheur, celui qui s’écroule renaît peu à peu. On dit qu’il faut deux ans pour faire un deuil... jusqu’à l ’acceptation de ce qui semble inacceptable? Est-ce cela faire son deuil de quelqu’un ? Un très beau texte qui va au-delà de l’intime.
Claire Petiteau
Ciné Télé Revue (Belgique) - « Un ouvrage sincère et bouleversant. »
L’auteur d’« Oscar et la Dame rose » retrace dans « Journal d’un amour perdu » les deux années de deuil qui ont suivi le décès de sa maman.
Un ouvrage sincère et bouleversant.
Dès la première phrase du livre, vous écrivez à propos de la mort de votre maman : « C’est la première fois qu’elle me fait de la peine. » Ça résume parfaitement la relation quasi fusionnelle que vous aviez avec elle...
C’était un amour épanoui. On savait tous les deux qu’on vivait une relation exceptionnelle. Vous nous laissiez ensemble à 10 h du matin et à 17 h, on était toujours en train de parler. On était deux âmes qui s’entendaient sublimement. D’ail- leurs, ce n’est pas une mère qui me manque, c’est avant tout la personne. C’était une histoire d’amour avant d’être une histoire de filiation. Même si, bien sûr, j’ai aussi perdu une maman et que je ne suis plus l’enfant de personne, ce qui change le rapport à la mort. Quand la génération précédente n’est plus là, on sait qu’on est le suivant.
Le livre aurait pu s’appeler « Le deuil dure deux ans »...
C’est un cliché qui me hérissait quand on me le disait. Comment pouvait-on ranger ce que je partageais d’unique avec ma mère sous une règle générale qui veut que le deuil dure deux ans ? Et pourtant, c’est ce qui s’est passé. Et ça a été pareil pour ma sœur. Après, je pense qu’un deuil dure toute une vie. Mais son moment insupportable, où la tristesse l’emporte sur le reste, dure effectivement deux ans.
Le fait que vous soyez croyant vous a aidé à surmonter votre chagrin ?
Non, absolument pas. Le manque de l’autre est là, sur cette terre, et c’est intolérable. On se pose en plus des questions que ne se pose pas un non-croyant. Comment ça se passe ? Est-ce qu’elle a peur ? On ressent une impuissance face à tout cela. Ça rajoute des coups de poignards. Pour autant, ça n’a pas ébranlé ma foi.
Vous avez plongé dans une terrible déprime, jusqu’à penser à vous suicider...
C’est le propre des gens actifs. J’ai vu plu- sieurs fois dans mon entourage des personnes très actives et dont on apprend un jour qu’elles se sont pendues ou tiré une balle dans la tête. C’est parce qu’elles ne supportent pas d’être passives face à la douleur. Et à ce moment-là, la seule façon d’agir, c’est de se supprimer. Heureusement, je ne suis pas passé à l’acte.
Vous avez plongé dans une terrible déprime, jusqu’à penser à vous suicider...
C’est le propre des gens actifs. J’ai vu plusieurs fois dans mon entourage des personnes très actives et dont on apprend un jour qu’elles se sont pendues ou tiré une balle dans la tête. C’est parce qu’elles ne supportent pas d’être passives face à la douleur. Et à ce moment-là, la seule façon d’agir, c’est de se supprimer. Heureusement, je ne suis pas passé à l’acte.
Dans ce genre d’épreuve, le travail est une bouée de sauvetage ?
C’est la bonne expression. C’est ce qui permet de ne pas sombrer totalement, de garder la tête hors de l’eau. Le travail m’a maintenu dans le présent. C’est le seul moment où je ne pensais pas à la perte de ma maman.
La mort de votre maman a aussi rouvert de vieilles cicatrices, puisque vous étiez persuadé que vous n’étiez pas le fils de votre père...
Autant j’avais une relation exceptionnelle avec ma mère, autant c’était plus compliqué avec mon père. Il y avait une défiance entre nous. Le regard de ma mère me donnait des ailes, celui de mon père avait plutôt tendance à les rogner. Pour- tant, c’était un homme bien et j’ai su qu’il m’adorait. Mais il se bloquait dès que j’étais face à lui.
Qu’est-ce qui vous a permis de surmonter votre chagrin ?
Ça se produit lorsque le passé cesse d’être un refuge pour devenir un enrichissement. Et puis, il y a le devoir de bonheur. Il faut à un moment donné décider d’être heureux. Ma mère m’a toujours fait comprendre que la vie était un cadeau. Je ne pou- vais pas continuer à cracher sur la vie qu’elle m’avait donnée sous prétexte qu’elle était partie.
FRÉDÉRIC SERONT
Le Pèlerin - « Un amour éperdu. »
Où est-elle, où voyage son âme, « a-t-elle été bien reçue là-haut ? J’aurais tellement voulu lui tenir la main. »
L’inquiétude aiguë de l’écrivain sur le sort de Jeanine, sa mère disparue, intrigue :sa foi profonde ne l’aide-t-elle pas à garder confiance ? Dans cette rentrée littéraire portée par de très belles figures féminines, l ’auteur met en scène la mère solaire qui a illuminé son enfance et partage, avec ses lecteurs, la douleur de l’avoir perdue. «Ma foin ’est pas un remède. Je dirai même qu ’elle aiguise ma souffrance, ajoutant à ma peine des questions qu’un incroyant ne se pose pas.» Pour Eric-Emmanuel Schmitt, croire n’est pas savoir mais habiter le mystère. L’espérance profonde qui le porte n’apaise pas le manque charnel de l ’inspiratrice de sa vie.«Je ne serais pas devenu un artiste épanoui sans son éveil au théâtre, à la musique et à la littérature. Je suis son œuvre. » Cette mère à l’amour inconditionnel était sa protectrice, son rempart contre le temps qui passe : « Quand maman est morte, je suis passé de l’état de fils à celui de vieux. Tant que nos parents sont devant nous, l’horizon recule en même temps que nous avançons ; les années s’additionnent. Quand ils disparaissent, l’horizon se fige, la soustraction commence. »
La prise de conscience de sa finitude a ébranlé l’écrivain avant de lui insuffler la force de surmonter l ’épreuve : « Puisque le temps était compté, il fallait que ma joie revienne. Je le devais à celle qui me l ’avait transmise. » Mais le fils orphelin s’est, d ’abord autorisé à vivre pleinement son chagrin. « Le temps de la peine est nécessaire. La tristesse n’est pas une pathologie, la mort non plus, les deux relèvent de la vie. J’ai eu besoin de me réfugier de longs mois dans le souvenir de l’absente. Depuis l’enfance, ma vie s’agrandissait du récit que je lui en faisais. J’ai continué à lui parler dans mon journal. » Un écrivain n’a pas le pouvoir de ressusciter les êtres mais il peut rendre la vie parles mots. Deux ans après la disparition de sa mère, l’auteur décide de faire un livre de son journal de deuil, un livre qui ne parle pas de lui mais de nous, de nous tous confrontés, un jour ou l’autre, à l’épreuve de la perte de nos parents. Nommer la douleur, tracer un chemin vers la lumière, n’est-ce pas le plus beau cadeau qu’un romancier puisse faire à ses lecteurs ? Avec l ’héritage maternel, Eric-Emmanuel Schmitt a acquis un Steinway.
«Tu n’arrêteras pas le piano !» le seul ordre jamais reçu, enfant, de sa mère
si aimante lui a permis de chérir la musique ! Pour son spectacle Madame Pylisnka et le secret de Chopin, l ’artiste a fait transporter l ’instrument sur la scène de son théâtre. Chaque soir au Théâtre Rive gauche, à Paris, le piano console et élève le public sous les doigts du grand pianiste Nicolas Stavy. Jeanine est vivante, elle vibre entre les notes de Chopin !
Catherine Lalanne
PAGES ( Les livres par les libraires ) - « Un très beau texte qui va au-delà de l’intime. »
«Maman est morte ce matin et c’est la première fois qu’elle me fait de la peine. » C’est sur ces mots que démarre le journal de l’auteur au jour de la disparition de celle qui l’a mis au monde. Ce journal relate les deux ans qui ont suivi et tout l’amour d’un fils pour sa mère. Deux ans de souvenirs, d ’anecdotes, de chagrin et de vie. Deux ans d’émotions, de souffrances et de bonheur. Deux ans de va-et-vient entre rires et larmes. Car pour ne pas trahir celle qui lui a tout donné - le goût de la vie, de la joie, la passion pour le théâtre et pour les arts en général -, il «s ’essaye au bonheur»... toujours. Et, pris dans cette contradiction, larmes inconsolables de cette perte incommensurable et souvenirs de tant de bonheur, celui qui s’écroule renaît peu à peu. On dit qu’il faut deux ans pour faire un deuil... jusqu’à l ’acceptation de ce qui semble inacceptable? Est-ce cela faire son deuil de quelqu’un ? Un très beau texte qui va au-delà de l’intime.
Claire Petiteau
Femme actuelle - « Un récit d’une infinie justesse, bouleversant ! »
Le romancier franco-belge se fait connaître dans les années 1990 avec ses pièces de théâtre (Le Visiteur, La Nuit de Valognes, Variations énigmatiques). Lorsqu’il se lance en littérature, son succès est tout aussi éblouissant (Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la Dame rose). L’écrivain signe un nouveau récit d’une infinie justesse, bouleversant, celui d’un fils terrassé par la disparition de sa mère. Pour Femme Actuelle Jeux Extra, il en explique le cheminement.
Dans Journal d'un amour perdu, vous parlez de vous et de votre peine. Est-ce plus difficile que d'écrire une fiction?
C’est plus difficile si on veut atteindre l’universel. Parler de soi, nous y sommes tous habitués. Quand on écrit, il s’agit de tout autre chose. C’est tendre un miroir aux lecteurs, s’adresser à chacun, mais en le faisant avec sincérité, sans fard. C’est une tension mentale considérable. Dans mon livre, j’évoque un désarroi, un équilibre perdu, rompu après la perte de celle auprès de qui j’ai marché durant cinquante ans, qui était une force.
Quelle différence avec La Nuit de feu, votre précédent titre autobiographique?
Il est du même ordre, à ceci près que, dans La Nuit de feu (sorti en 2015, ndlr) , je racontais une lumière qui s’éveillait. Là, c’est une lumière qui disparaît. Mais ce Journal est aussi le récit de l’amour pour la vie et comment, progressivement, je me remets à croire au bonheur parce que ma mère m’a élevé ainsi.
A quel moment avez-vous décidé de l'écrire?
Dès les premières heures. Je raconte dans mon Journal que j’avais l’habitude de vivre deux fois : une fois pour les relater à ma mère. Avec sa disparition, subitement, je ne possédais plus qu’une vie. Avec ce livre, c’est comme si j’avais toujours besoin de raconter ma vie à quelqu’un. La décision de publier a, elle, été tardive.
Avez-vous pu ainsi vous replonger dans le passé?
Il m’a permis de saisir que les souvenirs ont plusieurs poids. Parfois, ils alourdissent, parfois ils allègent. Aux premiers temps de cette mort, je m’y suis réfugié. Mes souvenirs étaient mon sanctuaire, mon chagrin, jusqu’à me rendre compte que je ne vivais plus le présent. Une forme de lutte pour me le réapproprier a émergé. Le théâtre et la scène m’ont aidé. A nouveau, je faisais ! Et puis est arrivé ce moment, évoqué à la fin du livre, où le rapport à mes souvenirs a changé: ils enrichissaient désormais le présent, lui donnant de la profondeur. Ils ne me pèsent plus : la tristesse n’est plus au premier plan et on se réjouit de ce qui a été.
Comment est accueilli votre ouvrage?
Par de nombreuses réactions belles et diverses, qui me laissent muet. Chacun y perçoit un bout de soi, mais différemment. C’est celui d’un enfant aimé ou désaimé. Pour certains, il renvoie au pardon au père, d’autres y voient le courage d’être soi, ou des rêves d’enfants réalisés. Mon livre raconte aussi cela.
Appréciez-vous ces réactions?
Absolument. C’ est ce que je cherchais, que les lecteurs revivent des expériences. Ce livre est un support, une loupe pour éclairer des charnières de vie. Un peu comme pour La Nuit de feu où l’athée comme le croyant s’y retrouvait. C’était un cheminement spirituel. Dans ce Journal, il est existentiel.
Comment un livre se fait-il jour?
Un livre naît toujours chez moi d’une situation, de celle qui révèle la profondeur humaine. L’Enfant de Noé (2004), par exemple, m’est venu lorsque j’ai appris l’histoire de ce prêtre qui avait non seule ment caché des enfants juifs durant la guerre, mais leur avait aménagé une synagogue dans la crypte même de son église. Cela m’avait ébloui
Et le nom de vos personnages?
C’est totalement inconscient. Lorsque je commence un livre, j’en choisis certains, mais souvent ils ne me conviennent pas. Je sais que ce ne sont pas les bons, sans que je m’explique vraiment pourquoi. Finalement d’autres s’imposent. Bien longtemps après, je comprends pourquoi cela ne pouvait être que ceux-là. C’est comme si une partie de mon esprit contenait mes histoires, mes personnages avec leur nom et que c’était à moi d’aller les chercher. Chaque nom est important, car il donne un destin.
Combien de temps vous demande un livre?
Il me faut des années pour le rêver et le méditer. Tel un fruit mûr, il me reste à le cueillir, et à écrire. Je compose lentement puis je rédige dans un élan. Je me compare à une femme qui porte un enfant, en fait, plutôt une « mère-éléphant ». J’accouche avec un sentiment mixte
de douleur et de désir. Et quand mon livre est là, je fais sa toilette, très, très soigneusement : je le polis et j’efface les traces du travail. Naturel mais épuisant !
Pouvez-vous nous dévoiler quelques éléments de votre prochain opus?
Ce sera une grande saga. C’est un projet auquel je pense depuis mes 25 ans. J’attendais d’être sûr de ma maturité. Mais il va prendre du temps, d’autant plus que je serai très souvent sur scène cette année et, en 2020, environ un jour sur trois pour interpréter Madame
Pylinska et le secret de Chopin, et Monsieur Ibrahim W et les fleurs du Coran. J’écrirai lorsque je ne jouerai pas, car toute l’énergie sera donnée sur scène.