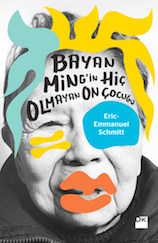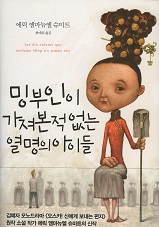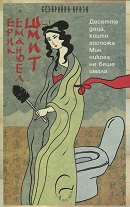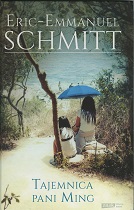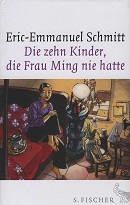Masterclass
Bandes annonces
Madame Pylinska et le secret de Chopin
Le visiteur
x (x)
Voir toutes les bandes annonces
- Accueil
- Littérature
- Récits
Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus.
Résumé
Sixième volet du Cycle de l’invisible.
Sortie le 5 avril 2012.
Madame Ming aime parler de ses dix enfants vivant dans divers lieux de l’immense Chine. Fabule-t-elle, au pays de l’enfant unique ? A-t-elle contourné la loi ?
Aurait-elle sombré dans une folie douce ? Et si cette progéniture n’était pas imaginaire ?
L’incroyable secret de madame Ming rejoint celui de la Chine d’hier et d’aujourd’hui, éclairé par la sagesse immémoriale de Confucius.
Dans la veine d’Oscar et la dame rose, de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ou de L’Enfant de Noé, Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus est le sixième récit du Cycle de l’invisible.
Critiques
Lire - « Grand Hôtel »
Ting Ting, Ho, Da-Xia, Kun, Kong, Li Mei, Wang, Ru, Zhou et Shuang : ce sont les prénoms des dix enfants que madame Ming prétend avoir eus. Fait étrange dans un pays, la Chine, dont le gouvernement pratique une très stricte politique des naissances. Qu'à cela ne tienne, madame Ming, jamais à court d’explications, va raconter en détail l'épopée de son incroyable maternité.
Au moment où le narrateur du récit d'Eric-Emmanuel Schmitt recueille ses confidences, elle est dame pipi dans le sous-sol du Grand Hôtel de Yunhai, un village de la province de Guangdong, devenu une ville de deux millions d'habitants. Quant à lui, il y travaille pour une firme spécialisée dans la commercialisation de jouets fabriqués en Chine et retravaillés en France par des stylistes permettant ainsi à des marques occidentales de dominer le marché chinois avec des marchandises pourtant fabriquées sur place. Il affirme avoir lui-même deux enfants, Fleur et Thierry, dont il n'hésite pas à montrer les photos à madame Ming.
Entre ces deux êtres que tout oppose culturellement, mais que tout rapproche affectivement, un étrange dialogue s'instaure durant lequel madame Ming présentera un à un les membres de sa prétendue progéniture, inventant peut-être l'ensemble des personnages peuplant ses rêves, ses songes, sa mythomanie.
Sixième volet de son Cycle de l'invisible, ce nouveau conte d'Eric-Emmanuel Schmitt intitulé Les Dix Enfants que madame Ming n'a jamais eus brosse une fois encore le portrait d'une femme, d'enfants, et d'humains en rupture d'identité qui cherchent à donner un sens à leur existence chaotique. On le sait : pour Eric-Emmanuel Schmitt la vie n'est pas absurde, mais mystérieuse, et c'est à l'issue d'un indispensable parcours initiatique que ce sens lui sera révélé. Cela passe chez l'auteur par l'immersion de tous les personnages de ses contes dans une forme différente de spiritualité. De la Chine de Mao dont elle conservera l’égalitarisme, à celle de Confucius dont elle perpétuera l'humanisme, madame Ming incarne une de ces héroïnes emblématiques de la volonté de s'élever par la force de l'esprit.
Privilégiant un style onirique, développant l'idée très romanesque selon laquelle « la vérité, c'est juste le mensonge qui nous plaît le plus», Eric-Emmanuel Schmitt signe un émouvant récit métaphorique en même temps qu'un hymne à la liberté de création.
Jean-Rémi Barland
Le Figaro littéraire - « La cinoque et le cynique »
Un voyageur de commerce français rencontre en Chine la très étrange Mme Ming.
Et si la sagesse passait parfois, voire souvent, par le mensonge ? Et si l'imagination, lorsqu'elle revêt les formes de la plus exquise des délicatesses, était le plus sûr chemin vers le bonheur ? À ces questions, Eric-Emmanuel Schmitt répond par l'affirmative, en nous envoûtant au fil des aventures drôles et sensibles de Mme Ming. C'est dans une fable s'inscrivant dans son « cycle de l'imaginaire », qui comprend notamment Oscar et la dame rose, que l'auteur nous transporte dans la Chine actuelle, à la rencontre d'une dame pipi hors norme...
Le narrateur, un voyageur de commerce français de passage dans le Grand Hôtel de Yunhai, entame un dialogue avec la très étrange Mme Ming. Cette femme va très vite lui raconter des mensonges en se vantant d'être la maman de dix enfants ! Comment, en effet, dans un pays où l'enfant unique est imposé par la loi, une telle famille nombreuse aurait-elle pu voir le jour ?
Reste que Mme Ming a un talent fou de conteuse. On jurerait qu'elle dit vrai. À travers les portraits savoureux de chacun de ses rejetons imaginaires, c'est toute la sagesse d'une Chinoise d'expérience, imprégnée par la philosophie de Confucius, qui jaillit. Quant à l'homme d'affaires, il est sous le charme de la dame, au point de finir par se demander si elle ne dirait pas, finalement, la vérité. Au point aussi que lui, le cynique célibataire endurci, en arrive à accepter, de retour à Paris, de devenir lui-même père.
"Jardins de mots"
Au bout du compte, c'est une jolie leçon de vie que nous offre Schmitt. Son héroïne sait nous séduire grâce à son imagination si poétique. Ainsi, par exemple, le lecteur savoure la description que Mme Ming fait de Wang, l'un de ses fistons, horticulteur à succès spécialisé dans la création de «jardins de mots. » La maman explique comment il "conçoit le parc idéal" pour ses clients : "Pour une somme correcte (...) il leur raconte sa disposition, ses dominantes colorées, ses étagements d'éclosions, ses diverses perspectives, les chants des oiseaux, les miroitements des eaux vives (...) et, pour quelques yuans de plus, il couche le résultat par écrit." Tout est là. Mme Ming, dont on découvrira le secret, agit comme un romancier. Ses mensonges libèrent une vérité, au-delà du réel.
BLAISE DE CHABALIER
Le Mediateaseur.fr - « Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus. »
Hier est paru aux éditions Albin Michel Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Il s’agit du sixième récit du Cycle de l’invisible débuté en 1997 avec Milarepa, suivront Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (2001), Oscar et la Dame rose (2002), L’enfant de Noé (2004) et Le sumo qui ne pouvait pas grossir (2009). Ce cycle ne contient que des récits qui traitent des religions.
Ici nous suivons le personnage de madame Ming à travers le récit de notre héros. Celui-ci n’a pas de nom, on ne sait s’il s’agit de l’auteur ou non, mais cela n’a pas d’importance, la personne centrale est cette dame pipi du Grand Hôtel de la province de Guandgong (Chine). Le narrateur fait sa connaissance un jour en étant dans les lieux pour affaires.
Suite à une photo qui tombe de sa poche, notre homme et cette dame pleine de sagesse vont faire connaissance jusqu’à devenir quasiment inséparables. Il faut dire que madame Ming à de quoi passionner. Dans ce pays à la règle de l’enfant unique, madame Ming, elle, a 10 enfants Ho, Da-Xia, les jumeaux Kun et Kong, Li Mei, Wang, Ting Ting, Ru, Zhou et Shuang.
Au travers de ses récits, elle captive notre héros qui, dès qu’il peut, descend aux toilettes pour entendre le portrait d’un autre enfant. Et pourtant au fond de lui, il sait que madame Ming est une menteuse et que 10 enfants, ce n’est pas possible, à moins que ?
Avec son style inimitable, Eric-Emmanuel Schmitt que l’on apprécie beaucoup (est-ce encore un secret) sait nous toucher, nous émouvoir, nous faire réfléchir et nous distraire en à peine plus de 100 pages. C’est le talent, et vous vous en rendrez compte en lisant ce très beau récit et en vous prenant très vite d’affection pour cette brave madame Ming.
Mathieu Henon
Sud Ouest - « Le discernement de la dame pipi »
Six mois après le superbe La Femme au miroir, Éric-Emmanuel Schmitt donne un tout petit conte bien moins léger qu'il n'en a l'air. Une dame pipi qui a lu Confucius confond un homme d'affaires appliqué à de sinueuses stratégies pour désarçonner ses partenaires. En dix récits, elle lui raconte ses dix enfants avec un accent de vérité qui déstabilise son interlocuteur, persuadé que la Chinoise n'a jamais enfanté aussi souvent. Madame Ming fait suite à Milarepa , Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la dame rose , L'Enfant de Noé et au Sumo qui ne pouvait pas grossir, ce cycle de l'invisible qui évoque les spiritualités du monde autres que celle de l'auteur. Derrière cette exploration, il y a un cheminement vers une sagesse universelle, un apaisement intérieur qui emprunte des voies diverses. Mais qui, toujours, revient à ce suprême bon sens d'accepter que les questions fondamentales restent sans réponse.
C'est dans cette petite douleur assumée qu'Éric-Emmanuel Schmitt place un certain bonheur. Avec la nécessité d'un regard sur l'autre. Ainsi, Mme Ming trouve sa dignité dans une autre vérité, la sienne, qui l'apaise, lui rend la vie plus acceptable et contribue au bonheur des siens. On ne peut que s'émerveiller de cette aisance avec laquelle le philosophe, chez Schmitt, emprunte son habileté à l'écrivain pour prêcher sans prosélytisme.
L'auteur recevra le 18e prix Ardua (Association régionale des diplômés des universités d'Aquitaine) mercredi prochain à Bordeaux
IS. DE Montvert-Chaussy
L'Express - « Eric-Emmanuel Schmitt va chercher l'amour en Chine »
Ting Ting, Ho, Da-Xia, Kun, Kong, Li Mei, Wang, Ru, Zhou et Shuang: ce sont les prénoms des dix enfants que madame Ming prétend avoir eus. Fait étrange dans un pays, la Chine, dont le gouvernement pratique une très stricte politique des naissances. Qu'à cela ne tienne, madame Ming, jamais à court d'explications, va raconter en détail l'épopée de son incroyable maternité.
Au moment où le narrateur du récit d'Eric-Emmanuel Schmitt recueille ses confidences, elle est dame pipi dans le sous-sol du Grand Hôtel de Yunhai, un village de la province de Guangdong, devenu une ville de deux millions d'habitants. Quant à lui, il y travaille pour une firme spécialisée dans la commercialisation de jouets fabriqués en Chine et retravaillés en France par des stylistes permettant ainsi à des marques occidentales de dominer le marché chinois avec des marchandises pourtant fabriquées sur place. Il affirme avoir lui-même deux enfants, Fleur et Thierry, dont il n'hésite pas à montrer les photos à madame Ming. Entre ces deux êtres que tout oppose culturellement, mais que tout rapproche affectivement, un étrange dialogue s'instaure durant lequel madame Ming présentera un à un les membres de sa prétendue progéniture, inventant peut-être l'ensemble des personnages peuplant ses rêves, ses songes, sa mythomanie.
Sixième volet de son Cycle de l'invisible, ce nouveau conte d'Eric-Emmanuel Schmitt intitulé Les Dix Enfants que madame Ming n'a jamais eus brosse une fois encore le portrait d'une femme, d'enfants, et d'humains en rupture d'identité qui cherchent à donner un sens à leur existence chaotique. On le sait: pour Eric-Emmanuel Schmitt la vie n'est pas absurde, mais mystérieuse, et c'est à l'issue d'un indispensable parcours initiatique que ce sens lui sera révélé. Cela passe chez l'auteur par l'immersion de tous les personnages de ses contes dans une forme différente de spiritualité. De la Chine de Mao dont elle conservera l'égalitarisme, à celle de Confucius dont elle perpétuera l'humanisme, madame Ming incarne une de ces héroïnes emblématiques de la volonté de s'élever par la force de l'esprit. Privilégiant un style onirique, développant l'idée très romanesque selon laquelle "la vérité, c'est juste le mensonge qui nous plaît le plus", Eric-Emmanuel Schmitt signe un émouvant récit métaphorique en même temps qu'un hymne à la liberté de création.
Jean-Rémi Barland
Carrefour savoirs - « Eric-Emmanuel Schmitt: un homme et des dieux. »
Une dame pipi d'un grand hôtel, pleine d'une folle sagesse, rencontre un homme d'affaires parisien aussi pragmatique que lâche. De leurs joutes verbales, Eric-Emmanuel Schmitt a tiré une de ces fables philosophiques dont il a le secret. Dernier opus du Cycle de l'invisible, Les dix enfants que madame Ming n’a jamais, est un voyage drôle au cœur du confucianisme.
Rencontre avec le plus pédagogue des philosophes
Vos ouvrages sont généralement des odes à l'une de vos passions : La musique, la philo, le théâtre ... Le Cycle de l'invisible en est-il une pour la foi ?
Eric-Emmanuel Schmitt: Ma véritable passion, c'est l'être humain ! Je ne m'intéresse pas aux religions pour des raisons religieuses mais humanistes. Je m'interroge sur ce qui fait battre le cœur des gens, comment ils parviennent à expliquer leur présence sur Terre et à donner un sens à ce qui leur arrive Plus que la religion, je me passionne pour les spiritualités ! Et j'ai un regard de curiosité bienveillante: je ne les juge pas, je ne les compare pas. Tous les contes du Cycle de l'invisible sont des rencontres distinctes avec des spiritualités.
Si l'on enlève les personnages et le ton de la parabole, n'essayez-vous pas, au fond, de converser avec Dieu ou plutôt les dieux ?
J'aime le dialogue. Attention : pas le débat mais l'échange! Je veux faire vivre un personnage avec une spiritualité loin de nous . . . de moi. Je veux créer un regard d'intérêt et cela, je l'ai vraiment compris lorsque j'ai écrit Monsieur Ibrahim et les-Fleurs du Coran, où un petit garçon juif rencontrait un épicier musulman. Au-delà de l'aspect de la fable, Monsieur Ibrahim provoque une sympathie qui nous pousse à vouloir suivre et comprendre sa spiritualité malgré notre tendance, j'allais dire naturelle, à l'islamophobie.
Vous dites avoir écrit des contes, mais dans tout conte n'y a-t-il pas une morale ? Or, vous prétendez ici vous garder d'en donner une...
Mes récits ne se veulent ni moralisateurs ni prêcheurs ni polémiques. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont été traduits dans plus de quarante langues. Je me contente de présenter les choses et j'essaie d'intéresser le lecteur avec une situation ou un personnage incongru. Là, je raconte le confucianisme à travers une histoire folle. La bouche de madame Ming est pleine de perles de Confucius: elle « parle Confucius » en permanence ! Mais est-elle vraiment sage? Je laisse le lecteur en décider- J'ai horreur des auteurs contagieux qui veulent que les autres pensent comme eux. Ce qui m'importe, c'est la liberté du lecteur.
Est-ce l'ancien professeur de philosophie qui parle?
Sans doute. Je disais tout le temps à mes étudiants: faites ce que je fais, mais ne dites pas ce que je dis. C'est-à-dire: réfléchissez par vous-mêmes, soyez libres. J'ai toujours pensé que donner un cours de philo revenait à donner la boîte à outils de la liberté. Pour les lecteurs, c'est pareil : voici des questions, des éléments de réponses et maintenant, vous faites ce que vous voulez...
Êtes-vous vous-même à la recherche des spiritualités ?
Oui, complètement ! Je cherche la meilleure manière d'habiter ce mystère qu'est notre vie. Juste parce que je suis curieux. Pas de connaître le bout du chemin mais le chemin lui-même, des rencontres qui le jalonnent, des spiritualités qui le bordent.
De toutes ces spiritualités, laquelle nous prépare à un au-delà le plus agréable ?
Je vais vous décevoir: la spiritualité n'est pas liée à l'appréhension de la mort mais à celle de la vie. La peur n'est pas le ferment des religions, ni leur origine, contrairement à ce que l'on pense. Moi, je crois et malgré ce que me dit ma religion, le christianisme, je ne sais rien sur la mort et je m'en fous! La spiritualité m'aide à vivre et non à mourir.
Alors, avec laquelle on vit le mieux?
Toute sont des guides au quotidien. Celle qui me paraît la plus folle, la plus excitante et la plus provocatrice, c'est le christianisme. Mettre l'amour au-dessus de tout, remplacer la peur entre les êtres par l'amour est une notion quasiment inaudible. C'est une spiritualité qui me bouscule : je ne suis pas comme ça et j'en suis même incapable, donc ce qu'elle me propose me grandit, me redresse et me rend tout petit aussi. Le christianisme est dingue, impossible, d'un romantisme exacerbé, il est ma maison.
Si vous n'aviez pas été chrétien et donc empreint de cette volonté d'amour, auriez-vous pu écrire sur d'autres religions avec la même impartialité ?
Oui, la philosophie m'aurait sauvé. Ce n'est pas ma religion qui m'aide à écrire sur les autres mais mon regard humaniste.
Quelle est la prochaine spiritualité que vous voulez explorer?
L'animisme africain. Je lutte contre mes idées d'Occidental pétri de philosophie et bourré de préjugés !
Laure Buisson
Le Parisien - « Une nouvelle fable pour l'auteur. »
Au sous-sol d'un grand hôtel du sud de la Chine, une dame pipi devise avec un commercial français. Entre cette vieille Chinoise et cet « Européen de passage» va se nouer une complicité : au fil de leurs rencontres, les deux êtres vont se raconter leur vie... Et surtout celle de leur progéniture. Avec Les dix Enfants que Mme Ming n'a jamais eus, qui vient de paraître, Eric- Emmanuel Schmitt, auteur de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, que joue actuellement Francis Lalanne, ajoute un sixième volet à son Cycle de l'invisible , entamé avec Milarepa ou Oscar et la dame rose .
Avec cette fable lumineuse sur le thème de la vérité et du mensonge, Schmitt régale une nouvelle fois ses lecteurs de sa langue claire et limpide et des aphorismes dont il a le secret (« La vérité m'a toujours fait regretter l'incertitude », « L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte »). Un récit métaphorique réjouissant.
C.BA.
La Denière Heure (Belgique) - « Le mensonge est artiste, pas faussaire »
Eric-Emmanuel Schmitt poursuit son cycle de l’invisible avec un texte court et follement poétique
“ La vérité, c’est le mensonge qui nous plaît le plus.” Voilà sans doute l’une des plus jolies phrases du dernier livre d’Eric-Emmanuel Schmitt. Mais il est difficile, du coup, de croire à son titre : Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus.
Dans ce texte court, qui s’inscrit dans le cycle de l’invisible – à l’instar d’Oscar et la dame rose ou de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran –, l’auteur se penche sur une sagesse, celle de Confucius, dont il ne cesse de s’émerveiller.
“Il y a des spiritualités dont j’étais tout à fait proche”, dit-il. “Mais là, c’est une sagesse lointaine. Il fallait que je la rende mienne, que ça fasse partie de ma chair. Le temps d’acclimatation a été assez long…”
Comment avez-vous approché cette spiritualité-là ?
“J’ai rencontré des gens qui sont porteurs de cette conception du monde. Et puis j’ai lu Confucius et beaucoup de littérature chinoise qui a ça comme une espèce de sang qui circule en elle. C’est un des thèmes du livre : les Chinois détruisent tout, démolissent les monuments, construisent des villes nouvelles mais il y a quelque chose d’antique, qui reste. La mémoire n’est pas dans la pierre, elle est dans les esprits. La Chine a été cimentée par une sagesse sans dieu. C’est peut-être plus puissant.”
La Chine est un pays qui vous est devenu familier ?
“Non, je ne vais pas vous mentir… La Chine, pour moi, est un objet d’investigation livresque. C’est une Chine connue plus que vécue.”
L’histoire que vous racontez – au-delà de la fable – est presque un thriller : on ne cesse de se demander si elle les a faits, ces enfants…
“Je suis d’abord un raconteur d’histoires ! J’étais fasciné par cette loi sur la natalité qui existe depuis le début des années 80 en Chine qui veut qu’on ne fasse qu’un enfant. Par empathie pour les Chinois, je me suis toujours dit que ça devait être un grand malheur. Plus personne n’a le droit de fonder une grande famille. C’est comme ça qu’est née Madame Ming. Mon histoire cache, je l’espère, une grande histoire d’amour filial. Que ces enfants existent ou pas, Madame Ming les aime. Si ce n’est pas la vérité des faits, c’est sa vérité à elle. Le mensonge est artiste, il n’est pas faussaire. Il dit le monde tel qu’il devrait être.”
Tout autre chose : vous deviez tourner Le sumo qui ne pouvait pas grossir. Où en êtes-vous ?
“J’ai vécu l’avortement de ce projet parce que le tsunami est arrivé. J’avais travaillé un an et demi… Ça m’a abattu, mais en même temps je n’allais pas me mettre à pleurer : qu’est-ce qu’un film par rapport à ce qui est arrivé aux Japonais ? Bref, du coup, j’ai beaucoup écrit… Je ne vais pas me plaindre : le monde du cinéma me courtise, les grands producteurs me demandent ce que je veux faire. Mais pour l’instant, je n’ai pas envie. J’espère que ça va revenir.”
Vous fonctionnez à ça, au manque et à l’envie ?
“Les symptômes, c’est ça : je ne me supporte plus, je me vois comme le plus grand paresseux de la terre, je râle. Là, dans mon entourage, on me dit qu’il faut que je me mette à écrire. Et à partir de là, je deviens charmant !
Isabelle Monnart
Le Soir (Belgique) - « Je me méfie de l’illusion de savoir. »
Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus est le dernier roman d’Eric-Emmanuel Schmitt. Il fait partie d’un cycle qui porte un regard sur les religions et les philosophies, où il y a aussi Milarepa, Monsieur Ibrahim, Oscar et la dame rose… Un roman très réussi, dans la sagesse, l’ironie, la peinture des personnages, l’allégresse du propos et l’écriture, rabotée, polie, efficace.
« En fait, je m’intéresse aux religions parce que je m’intéresse aux hommes, explique M. Schmitt. M’intéresser à Dieu, c’est autre chose, ça relève de l’intime, d’une sphère qui a plus à voir avec le mysticisme qu’avec l’étude des religions. Mon premier propos est de raconter une histoire, mais cette histoire est une porte d’accès à un monde. Derrière Madame Ming, il y a Confucius. »
Le roman est truffé de sentences tirées du Chinois d’il y a 2.600 ans. La plus marquante, cependant, « La vérité m’a toujours fait regretter l’incertitude », est de Schmitt lui-même. « J’aime l’incertitude, le mystère. Je me méfie de l’illusion de savoir. Je déteste les gens qui disent “Je sais” quand on ne peut pas savoir. Quand on m’interroge sur ma foi, je dis toujours :“Je ne sais pas si Dieu existe, mais je crois que oui. » Mon ami Comte-Sponville répond : “Mais je crois que non”. Là où j’ai peur c’est quand un Michel Onfray dit : “Je sais que non”. Ou un intégriste d’une quelconque religion :“Je sais que oui”. Ne pas confondre savoir et foi. L’enjeu d’une vie est d’arriver à habiter l’incertitude. »
Sous l’apparence d’une folle, Madame Ming est une sage. Et le narrateur, celui auquel elle se raconte, en profite pour apprendre. Sur le confucianisme, évidemment. Mais surtout sur lui-même. Jusqu’à la fin, où les violons s’enclenchent, un peu trop happy end sans doute. « Toutes les end des écrivains sont des happy end puisqu’elles leur plaisent. Moi je ne pouvais pas raconter une sagesse sans faire faire un trajet spirituel au personnage qui raconte cette sagesse. Si la rencontre avec Madame Ming ne lui permet pas de faire un voyage à l’intérieur de lui-même, si elle ne bougeait pas ses frontières intérieures et ne lui permettait pas de progresser, je pense que j’aurais raté cette rencontre. »
Après l’islam, le catholicisme, le bouddhisme, le confucianisme, Eric-Emmanuel Schmitt va encore se plonger dans les philosophies et religions. Les prochains contes, comme il dit, parleront des mythologies grecques et romaines et de l’animisme africain.
VANTROYEN,JEAN-CLAUDE
Le Matin Dimanche (Suisse) - « Voyage poétique au pays de Confucius »
Eric-Emmanuel Schmitt fait sans conteste partie de ces rares écrivains qui se bonifient au fil du temps. Il gagne en poésie, en puissance évocatrice, en acuité. Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus sont à ce titre une pure merveille, peut-être même l’un des meilleurs ouvrages de sa foisonnante bibliographie.
Ce bref roman nous propulse en Chine, dans la province industrialisée du Guangdong. Plus particulièrement dans les toilettes aseptisées à l’odeur de jasmin du sous-sol d’un grand hôtel. Entre «les carreaux de céramique blanche et les néons éblouissants», Eric-Emmanuel Schmitt nous conte le dialogue insolite, interrompu puis repris au fil des mois, entre un homme d’affaires français et la dame pipi de ces lieux singuliers. L’homme n’est pas pressé. Il a mis au point une technique de négociation fort efficace, qui consiste à user les nerfs de ses partenaires en brisant la discussion fréquemment pour s’absenter aux toilettes. De visite en visite, les échanges se font de plus en plus intimes, et Madame Ming de commencer à lui parler de ses dix enfants.
Mais voilà, nous sommes en Chine, et le Français n’ignore pas la réglementation du pays en termes de naissances: un seul enfant est autorisé dans chaque famille. La maîtresse des latrines se joue-t-elle de lui?
L’homme la pousse dans ses retranchements avec une foule de questions; Madame Ming ne semble jamais prise au dépourvu, répondant toujours avec mille et un détails fantasques. Ce qu’elle raconte serait donc possible? Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus s’apparentent alors à une magnifique fable autour des notions de vérité et d’imaginaire. Les réflexions, largement inspirées de Confucius, donnent par ailleurs à l’ensemble un ton philosophique aussi profond que proche de nos préoccupations quotidiennes. De descriptions poétiques pleines d’esprit à la fantaisie glorieuse de ce récit, Eric-Emmanuel Schmitt nous ensorcelle dans une musique proche de la perfection. La légèreté en plus.
Anne-Sylvie Sprenger
Le Journal de Québec (Canada) - « De dame pipi à héroïne »
Eric-Emmanuel Schmitt propose une fable magnifique qui soulève mille et une questions dans Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus. Un travail d’orfèvre, de philosophe, de fin observateur de la condition humaine et d’une spiritualité sans frontière.
Le sixième récit du Cycle de l’Invisible, qui nous a donné Oscar et la dame rose et Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, raconte l’histoire de Madame Ming, une dame pipi (préposée à l’entretien) des toilettes d’un grand hôtel chinois, qui aime parler de ses dix enfants, éparpillés à la grandeur du pays. Au pays de l’enfant unique, le voyageur de commerce qui la rencontre est en droit de se poser des questions. Et d’en poser à madame Ming, qui répond, fabule, imagine l’univers de cette importante progéniture. Son secret est éclairé par la sagesse millénaire de Confucius, grâce à l’immense talent de l’auteur.
« Ces petits textes et ces petits contes me prennent un temps fou. J’ai l’impression de devenir mon grand-père, qui était artisan. Il était joaillier-sertisseur, c’était lui qui enchâssait les pierres précieuses dans les bagues. Je le voyais toujours à son établi, passer des heures à s’occuper d’un bijou, à le polir. En même temps, j’adorais mon grand-père et c’était pour moi un exemple de ce qu’il fallait faire. Et quand je suis sur ces contes, je deviens comme lui : je passe des heures à polir », commente Eric-Emmanuel Schmitt en entrevue téléphonique.
Lois choquantes
Les lois natales de la Chine ont toujours choqué l’auteur. « Je comprends très bien la peur, pour les Chinois, d’avoir une population qu’ils ne pourraient pas nourrir; donc, je comprends très bien cette volonté de maîtriser les naissances et la population, et en même temps, je me suis toujours projeté dans les pères ou les mères chinois, en me disant quelle frustration ils devaient ressentir de ne pas pouvoir fonder une famille, d’être limités à un seul enfant. Donc, je me suis toujours dit qu’ils doivent se faire la liste des enfants qu’ils n’ont pas eus. Ils doivent se raconter toutes les existences des enfants qui ne sont pas nés. C’est un peu en rêvant sur la Chine que m’est venue la fantaisie du texte. »
Transformer une dame pipi en héroïne, dans son histoire, démontre sa volonté de transposer, par une femme humble, la Chine muette. « C’est la Chine soumise, la Chine qui se tait et en fait, elle est tout le contraire. Certes, elle est tout à fait humble, mais en même temps, elle trône, dans les toilettes de l’hôtel de Yunhai. Elle règne. Elle est la gardienne du soulagement. Tous les hommes sont égaux devant elle. Ça, ça m’amusait et je voulais justement que cette femme humble, modeste, se fasse entendre. »
La morale de l’équilibre
À son avis, ce qui a tenu l’âme chinoise à travers les siècles est justement le confucianisme, cette morale de l’équilibre. « C’est grâce à cette philosophie que les Chinois ont pu résister à tous les régimes dévastateurs qu’ils ont connus. Pour moi, c’est ça, l’âme chinoise. »
Eric-Emmanuel Schmitt est fasciné par la pensée de Confucius, qui a traversé 2 500 ans d’histoire en étant toujours aussi moderne. « C’est une sagesse qui vaut toujours aujourd’hui. Ce qui me fascine chez lui, c’est la recherche de l’harmonie. De l’entente entre les êtres. Pour lui, c’est plus important que la vérité.
« Il y a cette idée qu’il y a très peu dans les morales occidentales, qu’il faut préserver l’entente, le respect de l’autre, l’harmonie d’une famille ou l’harmonie sociale, à l’énoncé direct de la vérité. Au fond, le procès-verbal consistant à dire les faits est quelque part, parfois, assassin parce que ça peut tuer la sensibilité des êtres, les briser. Il vaut mieux préférer l’harmonie. »
D’où ces personnages qui fabulent, qui sont entre la vérité et le mensonge. « Confucius ne dit pas du tout qu’il faut mentir. Il n’est pas primordial de dire la vérité. Il y a des choses plus importantes : l’entente et le respect de l’autre. J’ai un peu résumé ça dans cette phrase qui finit le livre : la vérité m’a toujours fait regretter l’incertitude. »
Marie-France Bornais
Bsc News Magazine - « Madame Ming, une pythie qui allume la lumière »
Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus assoit d'abord sa fiction sur une réalité chinoise qui a entraîné des réponses politiques consternantes: face à une croissance démographique étourdissante, l'instinct maternel et paternel a été condamné à se restreindre et la politique de l'enfant unique est née, loi mise en place à la fin des années 1970 . Madame Ming est un de ces parents condamnés à respecter cette loi de restriction de la natalité pourtant elle affirme avoir dix adorables enfants: Ting Ting, Ho, Da-Xia, Kun, Kong, Li Mei, Wang, Ru, Zhou et Shuang! Est-elle une hors-la-loi ou une impertinente menteuse? Elle est en tous cas la dame pipi du Grand Hôtel où vient négocier régulièrement le narrateur français de ce conte; un homme d'affaires au cynisme délicieux et dont la vie sentimentale confuse est la conséquence de notre époque contemporaine survoltée. Sur son tabouret devant l'entrée des latrines, madame Ming trône en pythie et dispense, à qui a la sagesse de l'écouter, des aphorismes de Confucius. Elle incarne " la permanence dans un monde versatile, administrant les toilettes du Grand Hôtel comme si cet établissement avait toujours existé, et surtout comme s'il s'agissait d'une mission de la plus haute importance." Impressionné par cette femme à la posture stoïque, le narrateur instaure une discussion entrecoupée de longues pauses d'absence et de bouderies d'ego et c'est toujours la curiosité accrue pour cette dame mystérieuse qui le ramène devant les commodités masculines, son Royaume. Ces dix enfants dont madame Ming adore raconter les parcours si singuliers existent-ils vraiment? Leur existence réelle a-t-elle d'ailleurs une véritable importance? Telles sont les questions soulevées par un homme aux occupations quotidiennement mercantiles et lucratives qui finit par se demander si cette vieille dame n'a pas été volontairement placée sur son chemin.
Eric-Emmanuel Schmitt écrit ce récit comme on tire les fils des sujets d'un théâtre de marionnettes: rien n'est vrai si ce n'est l'humanité en marche dans chacune des respirations de la phrase et rien n'est faux si ce n'est peut-être la Vérité. Imprégné de spiritualité, ce conte poursuit la quête de tolérance et d'intelligence universelle dont le Cycle de l'Invisible se fait un portefaix inspiré. Un livre qui offre une leçon de modestie et une communicative envie de partager le Monde."L'Art est le plus beau des mensonges" disait Claude Debussy; pourtant Eric-Emmanuel Schmitt ne nous dit-il pas la vérité? Nous avons tendance à juger que ce qui est vrai est ce qui est réel. Or réalité et vérité sont deux choses distinctes; en prendre conscience peut avoir un effet salvateur et déculpabilisant sur les consciences. Ce qui est réel, c'est ce dont on reconnaît l'existence. Pourquoi alors madame Ming ne pourrait-elle croire qu'elle est la gardienne d'une progéniture nombreuse? "La vérité m'a toujours fait regretter l'incertitude", confesse-t-elle avant de s'endormir sur son lit d'hôpital. N'être sûr de rien est une posture de sagesse mais laisse aussi une part d'espoir qui rassure le sujet de confortables illusions. Dans ce sixième livre du Cycle de l'Invisible, Eric-Emmanuel Schmitt invente un conte pertinent où la vérité n'a pas plus de prix que celle d'un beau mensonge. Alors -bien sûr!- le mensonge est chose affreuse s'il est utilisé par des âmes perverses et calculatrices mais, lorsqu'il est "un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur" ( Albert Camus, La Chute), il mérite de s'épanouir et de vivre comme bon lui semble. La vérité serait-elle la seule posture acceptable sur laquelle le cours d'une vie doit s'édifier? Soyons sages et apprenons à découvrir que la beauté d'un être perce souvent dans l'étincelle qui fleurit au coin de l'œil, reflet des histoires singulières qu'il sait s'inventer avec délectation!
Julie Cadilhac
Le Républicain Lorrain - « La dame-pipi adepte de Confucius »
Qui ne connaît les principaux titres du Cycle de l'Invisible d'Eric-Emmanuel Schmitt? On se souvient d' Oscar et la dame rose , ou encore de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran , tous deux brillamment portés sur la scène et à l'écran. Aujourd'hui, l'auteur nous donne Les dix enfants que Madame Ming n'a jamais eus, étonnant conte qui met en scène un commercial français qui, dans les sous-sols de son hôtel chinois, est confronté aux dires d'une Madame Ming, dame pipi qui, dans le pays de l'enfant unique, prétend en avoir élevé dix vivant aux quatre coins de l'immense Chine.
L'écrivain-philosophe s'interroge, comme dans chacun des ouvrages de la collection, sur la signification que peuvent prendre la naissance, l'amour, une maladie « Le sens, dit-il, n'est pas dans les choses, mais les hommes doivent le deviner, l'imaginer, le recevoir. » Pour les y aider, Schmitt explore, à tour de rôle, les grandes spiritualités du monde, le bouddhisme, l'islam, le christianisme, le judaïsme, et il les appelle pour ainsi dire en renfort. « À chaque fois, écrit-il, il s'agit d'enfance – la virginité philosophique – et d'expérience. Je voyage dans les trésors humains. »
Dans Les dix enfants que Madame Ming n'a jamais eus, le trésor est la sagesse immémoriale de Confucius. La dame pipi du Grand Hôtel de la province de Guangdong en est profondément imprégnée, elle qui préside avec une dignité sans pareille aux latrines masculines de l'établissement: « Les mâles défilaient par milliers devant elle, la saluaient jusqu'à ce que, clémente, elle leur octroyât le droit au soulagement ». Et la noblesse de la dame Ming est telle que « l'endroit se muait en un laboratoire d'expérimentation métaphysique et morale où chaque mortel abandonnait l'illusion de la puissance »! Le hasard d'une photo échappée d'un portefeuille et un petit mensonge de circonstance vont entraîner les confidences de Madame Ming et une complicité certaine entre le commercial venu d'Occident et la Chinoise aux dix enfants dont les vies sont, chacune, un roman. On laissera au lecteur le bonheur de les découvrir, grâce à l'ingéniosité de Ting Ting, la fille de Madame Ming.
Notre commercial, lui, tout en recouvrant une parcelle d'humanité non négligeable, découvrira aussi que, « à la différence d'Européens qui visitent les cathédrales en délaissant le christianisme, les Chinois ne logent pas leur culture dans les pierres ». Pour eux, le monument demeure secondaire; ce qui compte, c'est « le cœur spirituel, gardé, transmis, vivant, plus solide que tout édifice ».
C'est que la sagesse réside dans l'invisible et non pas dans le minéral qui s'effrite.
Roger BICHELBERGER
La Tribune de la vente - « L'éclairage de Confucius »
Au travers de ses romans, contes, pièces de théâtre et essais, Eric-Emmanuel Schmitt nous démontre cet axiome« La contemplation ne nie pas l'action ». Après la découverte du judaïsme, du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, du zen, Eric-Emmanuel Schmitt, avec sa sensibilité à fleur de plume, convie à nouveau le lecteur et l'invite à se recentrer sur l'essentiel: l'humain.
Le nouveau conte de l'auteur, Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus, s'inscrit dans le cycle de l'invisible et redonne vie à Confucius. Madame Ming est une chinoise qui aime parler de ses dix enfants. Fabule-t-elle au pays de l'enfant unique ? Aurait-elle contourné la loi ? Est-ce une mythomane ? Cet ouvrage d'Eric-Emmanuel Schmitt mène le lecteur sur le chemin de la découverte, celle de Confucius, philosophe, éminent pédagogue et homme politique habile, l'une des grandes figures de la civilisation chinoise. Madame Ming porte la volonté de l'auteur de partager son amour du savoir et de la philosophie, son besoin d'ouvrir aux lecteurs de nouveaux horizons de pensées et d'approche à la fois de l'autre et de soi. « Nous souffrons au quotidien de nous donner trop d'importance. Le moi devient haïssable. Il suffit de cesser d'être victime de nous-mêmes. La pensée confucéenne est devenue en Chine un acte révolutionnaire qui permet- comme pour l'héroïne de mon conte- de dénoncer les excès et le despotisme tout en muant cette révolte intérieure en une élévation spirituelle. Peu importe la vérité. La vérité, n'est ce pas juste le mensonge qui nous plaît le plus ? »
Marie-Albéric Hallermeyer
Publications
- En langue allemande, chez Fischer Verlag
- En langue bulgare, chez Lege Artis
- En langue coréenne, édité pat les éditions Yolimwon
- En langue française, édité chez Albin Michel et en livre de Poche
- En langue italienne, publié par e/o
- En langue polonaise, publié par les éditions Znak
- En langue tchèque, publié par les éditions Motto
- En langue turque, publie par Dogan Egmont
Interview
Eric-Emmanuel Schmitt poursuit son «Cycle de l’invisible» avec Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus, une fable autour de Confucius.
Monsieur le directeur de théâtre: Eric-Emmanuel Schmitt rayonne, fier de son nouveau bébé, le théâtre Rive Gauche, sis rue de la Gaîté dans le quartier de Montparnasse et dont il est l’heureux nouveau propriétaire. Dans quinze jours, Francis Lalanne sera son Monsieur Ibrahim pour une reprise de ce qui est désormais une des pièces contemporaines les plus montées dans le monde. Et lui-même, pour remplacer son ami Francis en concert, montera sur scène à neuf reprises ce printemps. Un rêve de toujours, posséder un théâtre, qui se concrétise. Et un rôle de plus pour le romancier, dramaturge, réalisateur et essayiste franco-belge, 52 ans tout juste, traduit en 43 langues. En librairie, c’est son Cycle de l’invisible, cinq récits sur l’enfance et la spiritualité – Milarepa, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la dame rose, L’enfant de Noé et Le sumo qui ne pouvait pas grossir – qui s’enrichit d’un nouveau volet. Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus, fable subtile et émouvante dont l’héroïne, dame pipi au sous-sol d’un grand hôtel, raconte à un Occidental de passage la vie de ses enfants dont on ne sait s’ils sont réels ou imaginaires, prouve une nouvelle fois son talent de passeur et de conteur hors norme.
A travers l’histoire de madame Ming et de ses dix enfants, c’est le confucianisme que vous abordez. Confucius serait donc pertinent en 2012?
J’ai d’abord voulu raconter la tragédie d’une mère chinoise qui ne peut avoir qu’un enfant, et qui pour survivre à cette tragédie invente la vie des enfants que son pays lui interdit de mettre au monde. C’est une histoire folle dont j’ai trouvé la sagesse dans Confucius, qui nous propose une riche morale familiale. C’est une manière de tenter de décrypter le mystère chinois: depuis deux mille six cents ans, ni les variations politiques, ni le passage à l’économie de marché, ni aucun avatar historique n’enlèvent à ce pays le socle de confucianisme qui habite l’âme chinoise. C’est un peuple qui a admis sa pérennité dans l’invisible plutôt que dans le visible. Nous avons des cathédrales au milieu de nos villes, mais le christianisme s’est éloigné. Nous avons des amphithéâtres romains à ciel ouvert, mais l’esprit qui animait leur fonctionnement est très loin. Dans la civilisation chinoise, quasi rien ne reste de pierre mais l’esprit subsiste, car il passe du vivant au vivant.
Ce livre ajoute un sixième chapitre à votre «Cycle de l’invisible», entamé avec Milarepa en 1997. Une démarche qui répond à un plan initial?
Pas du tout! L’idée de ce cycle est d’ailleurs née en Suisse. Un journaliste qui m’interviewait sur Milarepa, dont la version scénique était créée au Théâtre de Vidy-Lausanne, a été très surpris d’apprendre que je n’étais pas bouddhiste tout en écrivant un récit sur le bouddhisme. Comme s’il fallait être Noir pour être antiraciste! J’ai pensé que c’était justement cela qui était intéressant et méritait d’être poursuivi: que je puisse parler avec considération d’une spiritualité qui n’est pas la mienne, sans que ce soit ni du prosélytisme ni de la critique. Du coup, cette démarche est devenue une vaste enquête sur les trésors de l’invisible que sont les spiritualités, soit la manière dont les hommes donnent du sens à la vie, comment l’invisible met de l’ordre dans le visible. J’ai commencé par aborder les religions – christianisme, islam, judaïsme – puis la spiritualité avec le bouddhisme zen et le bouddhisme tibétain. Madame Ming renouvelle le cycle puisqu’il plonge cette fois dans une sagesse, une philosophie du monde.
Quel travail d’écrivain se cache derrière chacune de ces fables brèves?
Ces petits textes, ces fables morales qui ne sont pas moralisantes, demandent un travail infini. Je les polis sans cesse pour arriver à l’essentiel. Chacune d’elles me prend des années, le temps que ce savoir devienne un territoire intime. J’ai absorbé le confucianisme depuis si longtemps que c’est en partie devenu du Schmitt. Une fois que la matière est prête à être régurgitée, je rédige en quelques semaines, en faisant attention à ce que le travail cache le travail, que l’art cache l’art. Un travail minutieux que j’adore: mon grand-père était artisan sertisseur. Je le voyais passer des heures à faire quelque chose que personne d’autre ne remarquerait. J’ai en tête un livre sur l’animisme africain, une des choses les plus difficiles à concevoir pour nous Européens. Cela fait quinze ans que je me bats pour en imprégner les fibres de mon esprit, de mon cœur. Et un jour, cela fera un petit texte de 50 pages. Pareil avec la mythologie gréco-latine: ce polythéisme n’existe plus, c’est un rayonnage avec des statues, mais c’est quelque chose que je comprends intimement et que je partagerai.
Chacun de vos livres ne contribue-t-il pas au grand souk contemporain en matière de spiritualité, chacun se servant comme dans un supermarché sans pour autant trouver le bonheur?
C’est le propre de l’époque moderne que de disposer de davantage de liberté dans la recherche des réponses aux questions existentielles que nous nous posons. Cette liberté peut mener certains au désarroi. Pour moi, c’est l’inverse: je suis émerveillé par les humains et leur invention spirituelle et philosophique. J’ai l’impression de découvrir des trésors, plutôt que de trébucher parce que je m’éloignerais de mes croyances de base. Et tout n’est pas si inconnu: la recherche du juste milieu de Confucius est aussi inscrite dans notre culture puisque à la même époque, dans le bassin méditerranéen, Aristote arrivait aux mêmes conclusions, prônait la même volonté de s’en sortir sans transcendance, développait une théorie politique indépendante de l’autorité religieuse. Je cherche la gangue universelle qu’il y a sous la diversité, ce qui est reconnaissable comme sagesse dans n’importe quelle culture et par n’importe quelle culture.
Du coup, toutes les spiritualités se valent-elles à vos yeux?
Non, ce qui se vaut, c’est la recherche de la sagesse. Ce que j’admire dans chaque civilisation, c’est l’effort pour en finir avec l’égoïsme, pour aller au-devant de l’autre et vivre en harmonie avec lui, l’effort pour s’arracher au malheur. Nous sommes tous frères en questions. Nos réponses nous singularisent, nous opposent parfois, mais c’est pour cela qu’il m’importe de toujours remonter à la question. Après, pour moi en tant qu’homme, les réponses ne pèsent pas toutes le même poids. J’ai toujours affirmé avec simplicité que le christianisme était ma maison, me nourrissait, et réglait une partie de ma vie.
Situation paradoxale: les lecteurs de votre «Cycle de l’invisible» cherchent des réponses et vous leur offrez toujours plus de questions...
Apprendre à vivre avec des questions qui n’auront jamais que des réponses provisoires est mon message récurrent. C’est cela, la philosophie: affûter son art de la question et savoir vivre avec la multiplicité de réponses possibles. J’ai tout fait pour ne pas être ignorant. Mais je n’ai obtenu des réponses qu’aux questions inintéressantes que je me posais – «Où est mon téléphone?», «Que mange-t-on ce soir?». Sur le sens de la vie et de la mort, je n’ai pas obtenu de réponses. Il faut accepter de vivre sur le mode du peut-être et ne pas le vivre avec douleur. Car ce doute peut mener à l’angoisse, au suicide, ou à une autre forme de mort cérébrale qui est le fanatisme, soit une terrible surcompensation du doute.
Une position très loin du rôle de gourou que l’on a parfois voulu vous faire jouer...
J’ai refusé tous les positionnements de gourou dans lesquels on a voulu me mettre. Je ne suis pas de ceux qui aiment que leur réponse soit contagieuse. Les rencontres littéraires se transforment facilement en café-philo avec moi parce que les gens me posent des questions spirituelles, mais je réponds avec l’honnêteté du philosophe que je suis, à savoir que la vérité est inaccessible.
Quelles sont les réponses provisoires intéressantes que vous trouvez chez Confucius via votre héroïne madame Ming?
Une forme d’apologie de la résistance, d’abord, comme l’herbe qui plie sous la tempête mais se redresse dès que possible. Ce qu’un Occidental peut voir comme de la lâcheté, de l’hypocrisie, est une dignité qui prend son temps, qui accepte l’humiliation provisoire. Et puis le fait que l’entente soit plus importante que la vérité: le vivre ensemble est plus important que la connaissance de la vérité, et la vertu n’est pas le vrai mais le bon. Ce qui va à l’encontre de la dictature de la transparence dans laquelle, sous l’influence du monde anglo-saxon, nous vivons. Enfin, ce souci du juste milieu me touche beaucoup. Ne pas confondre vengeance et justice, lutter contre la démesure et l’orgueil.
Avez-vous l’impression, au fil de votre vie et de vos livres, de devenir vous-même plus sage?
Comme tout homme, j’essaie de devenir plus sage. Parfois je pense y arriver, mais peut-être n’est-ce qu’une illusion de plus! Je n’en sais pas plus que les autres mais en tant que philosophe et écrivain, j’ai plus de temps à consacrer aux questions que je me pose et pour examiner les réponses des autres, avant de transmettre à mon tour tout cela.
Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus. D’Eric-Emmanuel Schmitt. Albin Michel, 116 p.
Interview accordée à Isabelle Falconnier pour L'Hebdo.